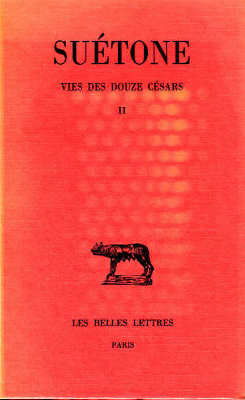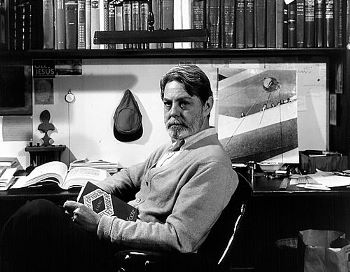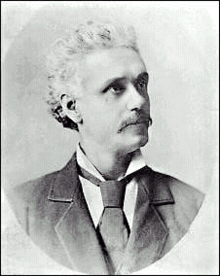|
|
Pour les chroniques précédentes de nos correspondants
cliquez sur
ce lien .
|
|
|
 Simon Popp
Simon Popp
Misogyne, moi ?
«C'est sûr, c'est sûr...», comme disait mon ex-confesseur (un jésuite).
Entendons-nous d'abord sur la définition du mot «misogyne» :
«Misogyne (du grec ancien μῖσος / mîsos, "haine"
; et du préfixe gyno-, "femme, femelle") :
personne qui a un sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des femmes
motivé par leur sexe biologique.»
En fouillant un peu, on peut lire dans certains dictionnaires, dans
le plus pur des styles académiques, que :
«La
misogynie] peut se manifester par des comportements violents
de nature verbale, physique ou sexuelle, pouvant dans des cas extrêmes aller jusqu’au meurtre.
La misogynie peut se manifester au sein des deux genres (hommes et femmes).
Le terme est sémantiquement antonymique à celui de misandrie (sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard d'un ou des hommes).
Dans certaines analyses féministes, la misogynie s’inscrirait dans un contexte d’oppression systémique et patriarcal.»
Ce que je comprends de ces définitions (qui me semblent toutes avoir
été rédigées par des hommes de loi) me pousse à dire ceci : Quand on me traite de misogyne, il
m'arrive plus souvent qu'autrement de penser aux pamphlets de Céline
pour me convaincre qu'il était aussi antisémiste que je suis
misogyne. Je ne
connais pas assez Céline pour savoir s'il était vraiment anti-juif.
J'en doute. Contre la stupidité humaine, oui, et de là, j'en ai conclu
il y a longtemps que dans tous ses écrits, particulièrement dans ses
si peu connus pamphlets,
il a tenté, à la manière de Lautréamont, de décrire l'humanité
de façon si demesurée qu'on finirait par la trouver grotesque au point
d'oublier qu'elle manifeste souvent une certaine grandeur ; sauf qu'il a oublié de
faire surgir de ses - encore une fois - si peu connus pamphlets
les icônes que l'on voit apparaître à la fin de l'Andrei Rublev
de Tarkovsky. Pensez-y un moment : est-ce que Hitler et sa bande auraient
pu avoir accès au pouvoir en distribuant avant d'être démocratiquement
élus des écrits comme ceux de
Céline ? Que
je lance à l'occasion des flèches - très peu vénimeuses - vers la
gente féminine (elle nous en lance tout autant et de la même variété -
quoi ? il faut savoir rire de soi), je ne les lance jamais pour les
blesser ; je m'adresse indirectement, je crois, à leur vanité - qu'est-ce que je dis là ! -
au plutôt système d'auto-défense
qu'elles adoptent trop souvent vis-à-vis la moindre
remarque ; ce qui me laisse supposer que'elles sont convaincues que mes flèches sont de la même catégorie que les véritables attaques
anti-femmes de, par exemple, ceux qui veulent, au XXe siècle, leur interdire,
dans certains pays ou certaines régions, le droit de vote ou, pire
encore, le droit à l'avortement - ou encore pire : dans ces milieux où
leur statut est celui d'esclaves. Mesdames,
je n'aurais aucune difficulté à rédiger des libelles diffamatoires ni
de subtils diatribes contre votre sexe. Je n'aurais qu'à répéter ce
que j'entends autour de moi depuis toujours, de la blague la plus
innocente aux réquisitoires les plus acerbes qu'on formule sur votre
compte. - Ne me faudrait même pas tremper ma plume dans du vitriol ;
entre l'encrier et mon papier, dix remontrances me viendraient à l'esprit.
L'homme, règle générale, est petit et mesquin, mais surtout craintif.
Il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Une fois, j'ai failli perdre pied devant une de vos représentantes
qui ne m'a pas laissé terminer ma phrase quand j'ai commencé à dire que
vous n'étiez pas égales aux hommes. Elle n'a pas entendu la fin : que
vous étiez mieux... enfin... que les hommes, de plusieurs façons vous étaient
inférieurs. D'abord, ils vivent moins longtemps. ce qui prouve
qu'ils n'ont pas votre résistance. - Puis ils s'intéressent plus aux
choses qu'à leurs prochains. ce qui explique peut-être le fait qu'il y a
plus d'ingénieus masculins que féminins (J'exagère, je sais, mais soyez
indulgentes.) - Ils sont, justement, moins indulgents. - La rancoeur, en ce sens,
devrait être un nom masculin tout comme la vengeance - Ils ont plus de
difficultés à supporter la douleur, la perte d'un être cher, les
insultes, les accusations sans fondement et que sais-je d'autres ? - Tenez
: je vois mal un homme accoucherou se faire violer et s'en remettre. -
Est-ce assez ? Je peux en ajouter : Le mensonge, la perfidie,
l'hypocrisie, la scélératesse, la tromperie vous sont plus difficiles.
Sauf quand vous aimez. Alors là... Mais bout de bon dieu ce que
vous pouvez aimer ! - Mieux que nous, ça c'est certain. Et, entre
vous et moi, les femmes sont plus belles que le plus beau des hommes.
*
Tiens, tiens...
Je viens d'apprendre que les remarques que j'ai formulées sur l'éducationnement
et l'igonranteté qui devaient être insérées
ici m'ont été refusées. - Une petite note accompagnant ce refus se
lisait : «Trop brèves, pas de conclusion, que des ouï-dire...».
Paraît que j'y laissais sous-entendre que les parents d'aujourd'hui
n'éduquaient plus leurs enfants. C'est faux : je parlais de mes parents
et des parents de mes parents.
Quoiqu'il en soit, je vais reprendre le tout et la version modifiée,
augmentée, corrigée et moins ouï-diresque fera l'objet de
remarques plus précises et dont auxquelles je parlerai de dans le
prochain Castor™ ; sauf que j'avais prévu y parler de la
solitude.
Tant pis, ça vous fera plus de choses à lire. En attendant, voici :
D'autres fonds de tiroir
-
J'hésite beaucoup à donner de l'argent aux mendiants
qu'on rencontre de plus en plus dans les rues des grandes villes. - Dieu
sait ce qu'ils feront de mon aumône. Dans le lot, je suis certain qu'il
y en a qui l'utiliseront pour faire imprimer leur CV et se trouver un
emploi, privant ainsi un fils d'une bonne famille d'une source de revenus qui
lui était destinée.
-
La question qui m'inquiète en ce moment, ce n'est pas
pourquoi certains perdent leurs emplois, mais pourquoi ceux qui en ont
les conservent.
-
Pour une raison que j'ignore, j'ai toujours pensé
que si je je prenais un livre d'introduction à n'importe quelle
science, je pourrais, petit à petit, en lisant les livres subséquenrts finir
par apprendre tout, par exemples, sur les mathématiques
supérieures, la phsysique nucléaire ou la cosmologie, jusqu'à ce
j'entende Richard Feynman dire que quiconque s'imaginait comprendre
la mécanique quantique ne comprenait pas la mécanique quantique.
-
Du temps où je vivais dan un appartement dans le centre-ville, j'avais quatre murs tapissés de bibliothèque où s'entassaient, classés par éditeurs, ce qui me restait de volumes après
cinq ou six élagages, les disques vinyles et 78 tours ayant, depuis
longtemps quant à eux, été ou donnés ou échangés contre de retentisantses notes
de bar et de restaurant. Un pan de mur ou presque servait uniquement pour les disques compacts et les partitions. Un classeur, trois bureaux, divers fauteuils, lampes, armoires, tables, guéridons, lampes et un buffet complétaient le reste. Un lit naturellement et des armoires mais pourquoi les mentionner ?
Classés par éditeurs, mes livres ? Oui, parce que chacun semble avoir adopté un ou deux formats qui rendent la hauteur des étagères plus faciles à ajuster.
Et trois bureaux ? Parce que. - Pour la même raison qu'il faut quatre oeufs à une femme menstruée (voir mon texte sur ls misoygie
ci-dessus) pour faire une omelette. PARCE QUE ÇA PREND QUATRE OEUFS !
(Voir ma chronique précédente sur la misogynie.)
À suivre...
Simon

|
|
|
 Herméningilde Pérec
Herméningilde Pérec
L'Église accomondante II
«Il est donc juste que, le deuxième millénaire du christianisme arrivant à son terme, l'Église prenne en charge, avec une conscience plus vive, le péché de ses enfants, dans le
souvenir de toutes les circonstances dans lesquelles, au cours de son histoire, ils se sont éloignés de l'esprit du Christ et de son Évangile, présentant au monde, non point le témoignage d'une vie inspirée par les valeurs de la foi, mais le spectacle de façons de penser et d'agir qui étaient de véritables formes de
contre- témoignage et de scandale. »
Jean-Paul II - 12 mars, 2000
(En réponse à une correspondante du Rwanda)
Oui, Madame, on reproche souvent à l'Église une, Sainte, Catholique et Apostolique qu'est l'Église de Rome ses dérapages,
cette Église qui, selon l'expression de saint Paul, est la présence dans l'espace et le temps, du corps du Christ dont elle est le sacrement, ce qui la rend présente et agissante dans le monde (1 Co 12,13 ; Ep 4,11).
C'est qu'on oublie qu'ELLE sait également également être, non seulement
accommodante, comme nous l'avons souligné dans notre dernière chronique, mais humble, modeste et respectueuse car
ELLE est prête en tout temps à demander pardon pour ses méprises, maladresses et égarements temporaires et c'est précisément ce
qu'ELLE a faite pas plus tard que lors de son Jubilé de l'an 2000, lorsqu'Elle a, par l'intermédiaire de son plus haut représentant,
le pape Jean-Paul II (cité ci-dessus), le 12 mars de la même année, appelé à une purification de la mémoire en insistant sur l'oubli des erreurs
qu'ELLE a commises pendant les deux premiers millénaires de son histoire parmi lesquelles
ELLE a mentionné en toute contrition :
- les Croisades,
- l'Inquisition,
- la Persécution des juifs(dont l'ananathème a été levé, on se souviendra en 1964),
- les Injustices commises envers les femmes,
- la Conversion forcée d'indigènes à travers le monde, notamment
en Amérique du Sud
et autres vétilles - au nombre de 94 - dont Elle avait déjà demandé pardon :
-
son appui indirecte à l'esclavagisme en Afrique (en 1995),
- l'approbabtion de la torture sous la Réforme (en
1995),
- l'admission que Galilée avait raison (en 1992)
- le sac de Constatinople (en 1904),
- l'abollition du parti catholique allemand pour permettre l'élection
de Hitler (en 1933),
- les Accords de Latran (1999),
- la condamnation au bucher de Jan Hus, de Giordano Bruno et
autres hérétiques
- etc., etc.
Et oui, Madame Ouama Dawit, ELLE se penche présentement sur les abus sexuels des
membres de son clergé .
Attendez-vous à une déclaration ad hoc d'ici peu.
Obédieusement et respectueusement vôtre,
H. Pérec

L'Église de Rome
Au service du Christ et de ses fidèles.

|
|
|
 Copernique Marshall
Copernique Marshall
Traduttore, traditore...
Sur la traduction d'un passage de Tacite
«Le
traducteur est un traite ?».
Peut-être, mais sans doute pire :
Un rappel d'abord :
(Extrait de l'intro à mes commentaires sur le «Mrs.
Dalloway» de Virginia Wolf le mois dernier) :
«Je voulais, ce mois-ci,
parler de Suétone et de Tacite, deux auteurs que Simon m'a suggérés
il y a plusieurs mois et que je n'ai commencé à lire il y a quelques
semaines, mais, quand j'ai lu mes notes, j'ai réalisé que j'étais
en train d'écrire un long essai sur ces deux historiens [...], chose qui ne convient
pas aux comptes-rendus généralement publiés dans le Castor™.
- Le temps de résumer tout cela, de mettre, comme dit Simon, de
l'ordre dans mes idées, et je vous reviendrai sous peu...»
Voir à ce propos la section Lectures de ce numéro.
Ce qui suit se rapporte uniquement aux textes dans
lesquels j'ai lu ces auteurs.
*
Simon m'ayant prêté ses éditions éditions bilingues (latin-français)
[des livres des deux auteurs mentionnés ci-dessus] et ne connaissant pas le latin comme
lui, j'ai lu
notamment Tacite, un bout en français, un bout en anglais (parfois les
deux à partir de textes récupérés ici et là) en
me référant quand même régulièrement, mais avec beaucoup de difficultés, au texte
latin.
C'est en des moments où je ne comprenais pas au
juste ce que le ou les traducteurs voulaient dire. En voici un exemple :
«Il y avait dans le camp un certain Percennius, autrefois chef de claque, depuis simple soldat, parleur audacieux, et instruit, parmi les cabales des histrions à
former des intrigues.»
Pour le mot «histrion», j'ai dû consulter un
dictionnaire : «Acteur antique qui jouait des farces grossières,
avec acompagnement de flûte», plus précisément, en France : «Cabotin,
charlatan ridicule» (Larousse) ; mais c'est surtout l'expression de
«chef de claque» qui m'a frappé. Cette traduction datant de
1833 (J. - L. Burnouf, un traducteur souvent cité
par ceux qui l'ont suivi), j'ai trouvé curieux qu'on l'utilisât déjà
à cette époque sauf que je l'ai retrouvée dans le Littré de 1863...
- Va pour les mots, mais comme elle était boiteuse, cette phrase, et
que je n'en comprenais pas trop le sens, j'ai fouillé plus loin.
Voyons d'abord le passsage qui suit dans sa langue
d'origine et dans diverses traductions :
En latin :
Erat in castris Percennius quidam, dux olim theatralium operarum, dein gragarius miles, procax lingua et miscere coetus histroionali studio
doctus.
En voici une traduction mot-à-mot (Merci
Simon !) :
Il y avait (Erat) dans le camp (in castris)
un certain (quidam) Percennius, chef (dux) autrefois ou jadis (olim)
d'ouvriers ou personnes [reliés au] théâtre (theatralium),
insolent parleur (procax lingua) [i.e. : à la langue
insolente] et ayant appris - ou : étant versé [dans] - (studio doctus)
à mêler [ou confondre] (miscere) des groupes ou
regroupements (coetus) d'acteurs ou de comédiens (histroionali).
Et quelques savantes traductions :
Dureau de Lamalle, 1840 :
Il y avait dans le camp un certain Percennius,
autrefois directeur de théâtre, depuis simple soldat, discoureur effronté, que toutes ses habitudes d'histrions avaient formé à l'intrigue.
Alfred John Church and William Jackson Brodribb,
1869 :
In the camp was one Percennius, who had once been a leader of one of the theatrical factions, then became a common soldier, had a saucy tongue, and had learnt from his applause of actors how to stir up a crowd.
Henri Goelzer (Éditions Belles Lettres), 1958
:
Il y avait au camp un certain Percennius, naguère chef de claque, puis simple soldat, effronté parleur et instruit par les rivalités entre histrions à
formenter des cabales.
Catherine Salles (Robert Laffont), 2014 :
Il y avait au camp un certain Percennius, naguère chef de claque, puis simple soldat, effronté parleur et instruit par les rivalités entre histrions à
formenter des cabales. (Une copie exacte de la précédente.)
Commentaires
À propos du latin et de la langue de Tacite :
Simon m'avait averti - et je l'ai lu dans les différentes
introductions aux livres qu'il m'a prêtés - que les règles
dans la langue latine sont largement du domaine de la fiction ; que
cela a toujours été su de ceux qui l'ont parlé ou écrit jusqu'au
XVIIIe et même XIXe siècle c'est-à-dire jusqu'à ce que le latin
commence à ne plus être considéré comme l'unique langue pour échanger
des informations spécialisées (science, philosophie, etc.) entre
ceux ne parlant pas la même langue. - Ne pas oublier que le
latin est toujours la langue officielle au Vatican...
(C'est une chose que les Allemands ont admis au
XIXe lorsqu'ils tentèrent, les premiers, d'écrire une grammaire
latine définitive !)
Et il m'avait également averti que le latin de
Tacite était particulièrement difficile à cause de son vocabulaire
très étendu et sa manie (sic) d'utiliser des mots rares ou anciens
qu'il combinait de façons spéciales par souci d'esthétisme.
À propos des traducteurs, maintenant :
Un aveu de ma part : sans être vraiment convaincu
que les traducteurs sont des traites, j'ai cru
comprendre, en lisant de plus en plus leurs traductions, qu'ils
avaient tendance à se considérer comme faisait partie d'une classe
à part, plus éduquée que le reste de nous, les simples mortels, qui ne
connaissons plus ou moins correctement qu'une seule langue ; et que,
de plus, ils se protégeaient entre eux. - Pour le dire sans ménagement,
j'ai tout de suite compris que les licences qu'ils se permettaient non pas
de traduire le plus fidèlement possible ce qu'ils lisaient,
mais qu'ils utilisaient ce qu'ils connaissaient d'une seconde langue pour
donner leur opinion sur ce qu'ils pensaient que l'auteur voulaient
parfois dire ou
- faute grave - pour exprimer leurs propes idées.
Pas tous, mais beaucoup plus que l'on pourrait soupçonner,
Une exception : ceux que Madame Malhasti dit ne pas
être des traducteurs, mais tradaptateurs ; dont la conviction
profonde est qu'on ne peut rien traduire, juste expliquer ou faire
comprendre ce qu'un auteur a probablement voulu dire en sugérant
toujours de s'en référer au texte originel.
Relisez les traductions précitées en ayant sous
les yeux ou toujours en tête la traduction mots-à-mots de Simon. Et
dites-moi qui a le mieux «adapté» la pensée de Tacite.
Copernique
*
One does not wallpaper a gold mine
(On ne pose pas de papier-peint sur les murs d'une mine d'or)
Je me suis tapé la semaine dernière - littéralement tapé
- un voyage-éclair (deux jours), aller-retour entre Montréal
(Napierville) et Wichita (Kansas) - Via Chicago à l'aller et via Chicago et
Toronto au retour.
C'est Daninos (1913-2005), je crois, celui des Carnets du
Major Thomson, qui citant une dame «de la haute»
qui lui avait dit que les conditions dans lesquelles on circulait dans le Métro
étaient «épouvantables», s'est posé la question suivantet : «Mais quel mot aurait-elle
utilisé pour parler du transport de ceux qu'on destinait aux camps de la
mort du temps des nazis ?»
Et c'est Ruskin (1819-1900), je crois, qui disait
que les architectes à l'origine des gares [de chemin de fer] auraient dû
utiliser leur talent à planifier, pour ceux qui y passent, la sortie la
plus rapide possible plutôt que de les décorer avec des colonnes aux
motifs que personne ne regarde. - «Qui, écrivait-il, consentirait
à payer supplément pour voir, à son départ ou à son arrivée, un décor
lui rappelant des plafonds d'un palais antique ? Et pourtant...
» (Je cite de mémoire) - Il disait en outre qu'il fallait être vraiment pressé pour emprunter des
chemins de fer construits par des gens qui se soucient peu des paysages, généralement derrière des banques et
des usines... - Voir ICI.
On frissonne à l'idée de ce que les deux écriraient aujourd'hui
sur nos aéroports démesurés où tout le monde court pour faire la queue,
recourt pour refaire une autre queue - parfois trois fois - afin de rejoindre un inconfortable fauteuil où,
après un décolage la plupart du temps en retard, on lui suggérera de
s'y attacher et de ne pas bouger pendant une heure, deux, trois, souvent
plus, jusqu'à ce qu'il puisse se relever et repartir à courir et
faire d'autres queues.
C'est vrai, et je crois que personne ne
me contradira là-dessus, que voyager en avion est devenu une véritable
corvée, surtout
depuis les mesures de «sécurité» qu'on a implantées depuis le 11 septembre
2001.
«Sécurité» mon oeil !
-
«Est-ce vous qui avez fait votre
valise ?» - Non, c'est mon beau-frère Mohamed...
-
«Déchaussez-vous, s'il vous plaît
!» - Je regrette, mais je voyage pieds nus
-
«Non : pas de couteau à bord. On
vous en remettra un avec votre repas.»
J'y reviendrai.

|
|
|
 Jeff Bollinger
Jeff Bollinger
Extra-terrestres, civilisations disparues et mensonges
Vite, parce que c'est la relâche
cette semaine. Relâche ! - Pas pour les parents. Ça c'est
certain. - D'ailleurs, au risque de nuire à ma carrière, s'il
n'en était qu'à moi, certains professeurs que je connais
devraient être en relâche permanente...
En attendant :
Je ne suis ni Simon, ni
Copernique, mais, comme eux, j'essaye de'apprendre certaines vérité
comme :
-
la terre a vraiment été formée peu à peu à partir d'une époque
datant de plusieurs millions d'années et non pas été créée
il y a moins de dix mille ans,
-
des hommes ont vraiment marché
sur la lune et qu'il ne s'agit pas d'une conspiration américaine
pour qu'on oublie les failles dans sa démocratie,
-
le mot «OVNI» se réfère
à des «objets non identifiés» et non à des appareils
conduits par des extra-terrestes
-
le Christ (s'il a vraiment
existé - sic !) n'était pas un moine boudhiste...
Sauf que des faux
renseignements comme ceux-là, j'en retrouve des dizaines et des
dizaines chaque jour.
Sauf que mes enfants font la même
chose et ne me disent pas tout.
Comment corriger dans leur
apprentissage les multiples erreurs auxquelles ils sont exposées
quotidiennement ?
Que dire, par exemple, à mon
plus vieux jeune qui a voulu un temps que tous les membres de
notre famille se soummettent à un test d'ADN pour nous assurer
que nous étions tous vraiment parents car il avait appris qu'au
Texas, récmment on avait remis le mauvais bébé à une femme
qui venait d'y accoucher.
Faut dire, quand même, que
nous n'avons jamais eu à lui desexpliquer qu'une cigogne
était à son origine.
Jeff

|
|
|
 Georges Gauvin
Georges Gauvin
On dit...
«On dit
Que j'aime les aigrettes
Les plum's et les toilettes
C'est vrai !
On dit
Que j'ai la voix qui traîne
En chantant mes rengaines
C'est vrai !
On dit
Que j'ai de grandes quenottes
Que j'ai que trois notes
C'est vrai !
Lorsque ça mont'
trop haut, moi je
m'arrête
Et d'ailleurs on n'est pas
Ici à l'opéra
On dit
Que j'ai l'nez en trompette
Mais j's'rai pas Mistinguett
Si j'n'étais pas comm' ça !»
(Chanson créée par
Mistinguett dans la revue «Folies en folies» aux Folies
Bergère en décembre 1933 - Paroles d'Albert Willemetz - Musique
de Casimir Oberfeld - Salabert, éditeur - Merci Paul !)
*
On dit...
On dit...
Qu'une femme de mon âge
Ne pense pas comme moi...
On dit...
Qu'une femme de mon âge
N'écrit pas comme moi
On dit...
Qu'une femme de mon âge
N'a jamais eu d'amants
On dit...
Qu'une femme de mon âge
Ne parle pas de ça !
Mais...
J's'rais pas George Gauvin
Si j'en parlais pas !
George

|
|
|
 Fawzi Malhasti
Fawzi Malhasti
Poésie choisie
Je ne sais plus, je ne veux plus
Je ne sais plus d'où naissait ma colère ;
Il a parlé... ses torts sont disparus ;
Ses yeux priaient, sa bouche voulait plaire :
Où fuyais-tu, ma timide colère ?
Je ne sais plus.
Je ne veux plus regarder ce que j'aime ;
Dès qu'il sourit tous mes pleurs sont perdus ;
En vain, par force ou par douceur suprême,
L'amour et lui veulent encor que j'aime ;
Je ne veux plus.
Je ne sais plus le fuir en son absence,
Tous mes serments alors sont superflus.
Sans me trahir, j'ai bravé sa présence ;
Mais sans mourir supporter son absence,
Je ne sais plus !
Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859)
Fawzi
P.-S. : Voir également
la section «Extrait du mois».

|
|
|
 De notre disc jockey - Paul Dubé
De notre disc jockey - Paul Dubé
Aimez-vous Brahms ?
«Vous en êtes
à combien [d'enregistrements]
?» me
demandait la fille d'un de nos lecteurs de longue date il y a deux
semaines.
Sortant de ma
poche mon téléphone-ouvre-boite-calculateur-blocs-notes... et
bilbophone, je lui ai répondu : «Le prochain sera le 354ième.»
«354ième !
Wow !» qu'elle dit et comme elle ne semblait pas idiote et qu'elle
avait de très beaux yeux, nous avons jasé un brin.
354. Oui, le
nombre peut paraître, mais réparti sur 14 ans, cela ne fait que 25 ou à
peu près par année d'autant plus que, depuis un
bon bout de temps déjà, le Castor™ n'en diffuse qu'un par mois. Au
début, c'était un par semaine. Nous étions alors, nous les
chroniqueurs, de véritables forçats.
Je lui ai
demandé si elle connaissaît Brahms, l'objet de l'enregistrement que je
voulais faire jouer cette semaine, mais elle n'avait entendu parler
vaguement que du roman. Faut dire que ce vénérable vieillard est décédé
depuis déjà un bon bout de temps et qu'il a quelque peu perdu sa cote.
Il en sera sans doute de même pour les derniers survivants du «véritable
rock» quand seront disparus ceux qui ne jurent que par le Hard
Rock quoique... avant que les aujourd'hui-plus-jeunes-du-tout
inconditionnels d'Elvis en ont encore pour quelques années...
Tenez. Lisez
ceci :
«Davis,
Miles - Trompette né à Alton, Illinois, en 1926, qui a délibérément
tourné le dos à la tradition musicale de sa race et qu'on peut citer en
modèle d'anti-jazz.»
Vous croyez que
j'invente ? pas du tout. C'est ainsi que Davis fut défini dans Le
dictionnaire du Jazz de Hugues Panassié paru, dans sa dernière édition
(je crois), chez Albin Michel en 1971. (Hugues Panasié est décédé en
1974.)
Oui, on peut
sourire à la lecture de ce jugement - de cette condamnation, plutôt - de
ce Panassié hautement décrié pat Boris Vian et les amateurs de Be-Bop,
tout comme j'aurai pu rire de la boutade de ma jolie autour-d'un-café
compagne de l'autre jour avec son «Aimez-vous Brhams ?» de François
Sagan, mais alors, pourquoi ne pas rire de ma réaction (souvent indiscrète)
vis-à-vis les rapeurs ? Ou les ceusses qui viendront avec leurs nouveaux
instruments jouer une musique que je n'aurai - permettez que j'ajoute ici
le mot «heureusement» - pas à attendre à moins qu'on m'enterre
avec un portable.
Simon a raison
quand il dit qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes limités à
l'espace-temps que nous traversons dans cette vallé de larmes qui
est la nôtre et encore : je sais que mon espace-temps-musique ne dépassera
pas ce que j'ai entendu de ma naissance à aller jusqu'à il y a une bonne
dizaine d'années. Ce qui est venu avant, j'y goûte qu'avec beaucoup de
difficultés, n'y recherchant que des sources de ce que j'ai connu et ce
qui est en train de survenir après commence à me tomber sur les nerfs.
Mais oublions
Brahms pour aujourd'hui et faisons tourner le classique : «So What ?»
joué par le célèbre sextet de Miles Davis en 1959. il y aura 60 ans
cette année.
À la trompette
: Miles Davis. Au sax ténor : John Coltrane. Au sax alto : Cannonball
Adderley. Au piano : Bill Evans. À la contrebasse : Paul Chambers. - À la
batterie : Jimmie Cobb.
Pauvre Jimmie
Cobb ! Il a cru qu'il avait ruiné la pièce en faisant éclater sa cymbale
après l'introduction Evans-Chambers ! - Cette intriduction ? Elle est
l'oeuvre de Gil Evans.
Bonne écoute.
Pour
écouter, cliquez sur la note : 
paul
P.-S.
: Et tant pis si vous n'entendez pas la contrebasse sur les hauts-parleurs
de votre ordi. Vous manquez quelque chose.
***
Note : pour nos suggestions et enregistrements précédents, cliquez ICI.

|
|
|
Lectures
Note :
Les textes qui suivent - et les précédents - ne doivent pas être considérés comme de véritables critiques au sens de «jugements basés sur les mérites, défauts, qualités et imperfections» des livres, revues ou adaptations cinématographiques qui y sont mentionnés. Ils se veulent surtout être de commentaires, souvent sans rapport direct avec les oeuvres au sujet desquelles les chroniqueurs qui les signent désirent donner leurs opinions, opinions que n'endosse pas nécessairement la direction du Castor™ ni celle de l'Université de Napierville.
|
De mon éditeur favori...
C'est en mai dernier - j'ai vérifié, moi qui ne me relis jamais - que j'ai parlé de la langue académique ou de l'académisme dans une chronique qui donnait suite à des propos que j'avais tenu le mois précédent sur l'utilité des travaux (mémoires, thèses, etc.) qu'on exigeait pour l'obtention de certains diplômes.
Et voilà, qu'au début de mois dernier, on m'a suggèré un livre dont je vous donnerai le titre dans quelques
instants et à la partie conclusion duquel je suis tout de suite passé. Voici ce
que j'y ai lu (premier paragraphe) :
«On ne peut penser l’incommunicable, mais on peut en penser la
communication. Affrontant ce paradoxe ou cette "idée folle", la circonscrivant en tant qu’expérience d’une anomalie, d’une communauté ou d’un retour de l’être, Klossowski se fait penseur de la médiation
et de ce que l’on appellerait aujourd’hui, des médias. Car quel est le dénominateur commun des différents concepts que nous avons rencontrés :
diabolus interpolator, signe unique, pure parole,
Stimmung, sémiotique pulsionnelle ou encore fable, sinon leur fonction de média, différenciant et simultanément articulant l’espace de l’incommunicable avec le code des signes quotidiens ? Et telle n'est pas la moindre originalité de...»
De là, je suis passé à l'introduction pour noter qu'en huit pages l'auteur avait trouvé le moyen d'insérer pas moins de 44 notes en bas de page citant - je ne les ai pas comptés - au strict minimum une vingtaine d'auteurs dont : Heidegger, Monnoyer, Wittgenstein, Nietzsche, Gide, Blanchot, Sade, Bizet (François), Zweig, Castanet, Thierry Tremblay et Alain Arnaud...
Le titre du livre ? «Klossowski, l'incommunicable - Lectures complices de Gide, Bataille et Nieztsche». - Son premier chapitre ? «Gide ou la parrhésie».
Parrhésie : «La parrhésie (substantif féminin),
du grec pan (« tout ») et rhema (« ce qui est dit ») est une figure de style consistant en une adjonction qui consiste à dire ce qu'on a de plus intime en cherchant ses mots ; elle est proche de la licence et du franc parler.»
Chez Droz, à Genève (qui d'autre ?) - 378 pages, 2015.
- Son auteur : Slaven Jean-Philippe Waelti, de l'Institut Französische
Sprach und literaturwissesnschaft (Basel, Suisse).

Je n'ai consulté ce livre qu'en format pdf et ne peux , de ce fait, en décrire la forme physique, mais, connaissant l'éditeur et le nombre de pages, je crois qu'il eut été tout à fait parfait pour stabiliser une de mes bibliothèques qui, depuis quelques jours,
est devenue bancale. - Bah, ne vous en faites pas ! Je dois bien avoir un Goncourt ici, quelque part qui fera tout aussi bien l'affaire.
Simon
*
Un grand programme :
Louis Madelin - Histoire du Consulat et de
l'Empire - Bouquin Laffont, 2003
Édition en 4 volumes (4.436 pages) de l'édition originelle en 16 vols.
(1937-1953)
Tacite - Oeuvres complètes - Laffont, 2014
Un volume - Préface et nouvelles traductions de Catherine Salles - 860
pages
Tacite - Histoires - Édition bilingue
(Latin et Français) - Les Belles Lettres, 1921
Trois volumes - Texte établi et traduit par Henri Goelzer
Suétone - Vie des douze Césars - Édition
bilingue - Les Belles Lettres, 1989
Deux volumes - Texte établie et traduit par Henri Ailloud
Pline le Jeune - Lettres - Livres I à X -
Les Belles Lettres, 1948, réimpression de 2009
Quatre volumes - Texte étatbli et traduit par Marcel Drurry
*
Ne vous en faites pas : je n'ai pas l'intention -
comme dirait Simon (qui m'a suggéré ces titres [sauf le premier]) - de
vous parler en détails de ces «chefs-d'oeuvre». - Juste
vous en donner un aperçu et, comme d'habitude, faire des commentaires
qui n'ont aucun rapport avec leurs contenus.
Mais lire d'abord ce que je dis des traducteurs dans
ma chronique de cette semaine.


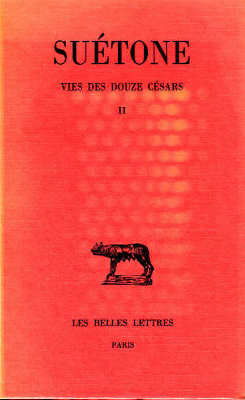

L'histoire d'abord :
J'ai toujours eu de la difficulté avec l'histoire,
l'Histoire (avec un grand «H») et conséquemment les historiens.
Une note, mais importante ; je n'ai jamais mis en
doute leur honnêteté dans leurs tentatives de
nous raconter sans parti pris notre passé. - Enfin : pas trop.
Le problème est que je leur
ai toujours reproché de tout ramener à des batailles et des dates ;
à des noms également ; des noms de rois, de conquérants, de révolutionaires,
d'envahisseurs ou de fermenteurs de révolution. Les épidémies, les
variations climatiques, tous les
cataclysmes qui, régulièrement se sont abattus sur notre planète et
qui ont eu une influence plus considérable que toutes ces batailles
et tous ces noms sur notre évolution semblent, sauf dans
de rares cas, leur avoir échappés. -
Comme Simon le disait dans sa chronique du mois dernier, citant le
biographe de Jerry Roll Morton, il est certain qu'Oedipe-Roi n'a pas
été un personnage historique, mais son histoire, sa tragédie, nous enseigne beaucoup plus sur ce que nous
sommes
que toutes les descriptions
détaillées de batailles ou de rencontres au sommet et, depuis
des années, tout ce qu'on peut voir et entendre dans les émissions
dites d'informations à la télé.
Oui, je peux comprendre pourquoi on puisse s'intéresser
à des hommes comme Hadrien, Charlemagne, Talleyrand, Jefferson ou de
Gaule, mais examiner à la loupe la vie de Constantin, la bataille
de Soissons, les journées du 31 mai et du 2 juin 1793 ou l'exil en
Angleterre de Napoléon III me paraît d'une grande futilité pour...
expliquer notre histoire.
Et puis, deux, trois autres choses me reviennent
constamment en tête quand je pense à l'Histoire :
- Que les professeurs d'histoire dont le rôle souvent
se limite à
enseigner leurs connaisances à des futurs professeurs d'histoire ont
tendance - forcément parce qu'ils ont reçu leur formation de
professeurs d'histoire - à vanter les mérites de leurs prédécesseurs.
- Suffit de lire les remerciements qu'ils dispersent à profusion
dans les préfaces de leurs écrits.
- Que parmi les grands historiens, plusieurs n'ont
jamais reçu de formations spécifiques et, de ce fait, ont parfois
ont été plus intéressants que ces examinateurs à la loupe de
faits sans importance.
- Que les historiens qui ont écrit de façon très
personnel, contournant parfois l'authenticié de certains faits au
profit d'une vision hautement discutable de l'Histoire, (avec un
grand «H», je le rappelle), sont souvent plus perspicaces dans
leurs jugements que ceux dont les notes
en bas de page nous renvoient à des preuves irréfutables.
C'est à peu près ce à quoi j'ai pensé en
parcourant, pendant plusieurs jours, parfois en lisant de longs
passages et même en entier de larges sections des
livres mentionnés ci-dessus. - Voici en bref ce que j'en ai pensé :
Pline ? Oui. Au complet sauf son
Panagyrique de Trajan qu'on ajoute régulièrement à sa
correspondance. - Pas un livre d'histoire, à proprement parler, mais
un tableau extraordinaire de la vie dans l'Empire Romain vue par un
personnage fascinant qui m'a rappelé que plus ça change...
Suétone ? - En partie. -
Beaucoup de fait divers qui ne m'en ont pas appris davantage - je veux
dire réellement - sur ses textes sur la vie de douze César.
Madelin ? - Non. - Disons que 4,436
pages qui débutent par «Ce livre et celui qui le suivra ne sont
que les volumes introductifs à une histoire du Consulat et de
l'Empire...» (C'est moi qui souligne) ne font pas partie de mes
intérêts pour le moment. J'attendrai plutôt le film. - À
souligner, quand même, son index comparable à celui qui suit l'aussi
illisible Journal des Goncourt.
Tacite ? - Alors là, un oui
inconditionnel. Non pas parce qu'il est historiquement correct,
mais parce qu'il décrit des événements tels qu'il les a perçu,
lui, dans un contexte fort différent du nôtre. Il ne savait pas ou
ne se doutait pas ? que l'Empire Romain allait un jour s'écrouler,
que les personnages qu'il décrit n'auront qu'une valeur relative
minime mille, deux mille ans après leur disparition, que son style, sa
manière de décrire ce qu'il pensait être la vérité allait nous en
apprendre plus sur son époque que tous les historiens qui allaient le
suivre et dont la majeure partie de leurs travaux n'allaient tendre
qu' à déterminer la date exacte de tel ou tel événement ou si
Vercingétorix était gaucher (ce qui expliquerait...)
Shelby Foote qu'on a souvent cité
ici et qui fut l'auteur d'une narration en trois volumes de la
Guerre Civile américaine et qui n'était pas historien du tout - c'était
d'abord et avant tout un romancier et sudiste par dessus le marché -
s'est dit très heureux, un jour, d'apprendre que, dans une thèse à
propos de cette partie de son oeuvre, une étudiante en histoire de
l'Université de *** (aux USA), avait tenté de démontrer que sa
narration était beaucoup plus près de la véritable histoire de cet
épisode cruciale de l'histoire américaine, parce que, contemporain,
il l'avait vécue de près et non avec le recul de la plupart des
historiens. (On sait que Shelby Foote est né en 1916 et qu'en conséquence...)
- «Je suis très content qu'elle ait pensé cela, dit-il en
entrevue, parce que c'est précisément le but que j'ai visé.»
De ce point de vue, Tacite fut un
grand historien. Probablement celui qui nous aura fait connaître le
monde romain (à une certaine époque) mieux que quiconque. - Mais
attention, hein ! Il est très difficile à lire à cause de ses archaïsmes,
ses tournures de phrase et... ses préjugés. - Shelby Foote en était
un grand admirateur. - Ce sont des aspects qu'on ne retrouve pas chez
Pline, mais Pline ne s'est jamais voulu historien.
Je reviendrai un jour sur l'histoire
car Simon m'a refilé récemment un cartable contenant des centaines
de Unes de journaux du début du siècle dernier... - Je n'en
suis pas encore revenu.
Copernique
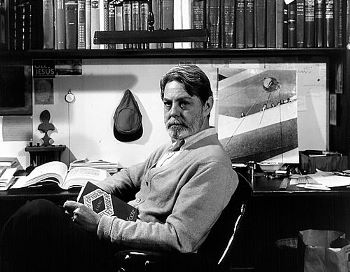
Shelby Foote
(1916-2005)
(Photo : Charles Nicolas - The Commercial Appeal)

|
|
|
L'extrait du mois
Une note d'abord, de Madame Malhasti :
Le déménagement du siège social du
Castor™ a eu pour effet de nous faire découvrir une région peu
connue ou relativement peu documentée de notre Province, celle qui
s'entend à l'ouest de l'île de Montréal jusqu'à la frontière
ontarienne au nord du fleuve Saint-Laurent et au sud de la rivière
des Outaouais. Cette région a pourtant beaucoup d'histoire selon, entre
autres, trois documents que nous a fait parvenir un
de nos lecteurs, Monsieur Jean-Luc Allard.
Ces documents que nous avons lus avec
beaucoup d'intérêt. soulignent l'importance, entre autres, de trois
villages situés du côté nord du fleuve et connus au départ sous les
noms de
: Côteaux-du-Lac, Côteaux-Landing et Côteaux-Station. Pour les
situer, ils étaient et sont toujours en face de la ville de Sallaberry-de-Valleyfield, à la fin,
côté est, du
Lac Saint-François.
Dans ces documents, on y apprend que
Coteaux-Landing, en particulier, a été un point où se sont arrêtés
des personnages tels que le Cavalier de La Salle (1669), Frontenac (1673), Lamothe-Cadillac (1710), Charlevoix (1721), La Vérendrye
(1731) et plusieurs autres.
Ces documents
peuvent être consultés diverses pages à suivre.
En fouillant
quelque peu, j'ai appris qu'Oscar Dunn (1845-1885),
un jounaliste francophone qui acontribué au cours de sa courte carrière au
Courrier de Saint-Hyacinthe, La Minerve, Le Journal de paris, le Nouveau
Monde, Le Bien public, l'Opinion public et d'autres, était né à Côteau-du-Lac.
Pour plus de renseignements sur lui, voir
la page suivante :
http://www.biographi.ca/en/bio/dunn_oscar_11E.html
Parmi ses écrits celui qui attira
particulièrement mon attention fut un commentaire qu'il publia dans Le
Bien Public, le 9 juin 1874, sur un texte d'un autre journaliste,
commentaire qu'il intitula un «étrange document».
Cet autre journaliste n'était nul autre
qu'Arthur Buies qui faisait paraître le jour même, la veille de
son départ pour la Californie, un étrange doccument, en effet,
étrange mais également unique en ce qui le concerne. Ce document
paraissait ce jour-là sous le nom de Despéranza.
Pour plus de renseignements sur Arthur
Buies, consulter la page que lui a consacrée l'encyclopédie Wikipedia
: https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Buies
Quant à ce Desperanza, le voici :
(L'introduction d'Oscar Dunn fait
partie du deuxième volume des Chroniques d'Arthur Buies
publiées par La Bibliothèue Nationale du Québec (Les Presses de
l'université de Montréal) en 1991.)

Desperanza
«Je suis né il y a trente ans passés, et depuis lors je suis orphelin. De ma mère je ne
connus que son tombeau, seize ans plus tard, dans un cimetière abandonné, à mille
lieues de l’endroit où je vis le jour. Ce tombeau était une petite pierre déjà noire, presque cachée sous la mousse, loin des regards, sans doute oubliée depuis longtemps. Peut-être seul dans le monde y suis-je venu pleurer et prier.
«Je fus longtemps sans pouvoir retracer son nom gravé dans la pierre ; une inscription presqu’illisible disait qu’elle était morte à vingt-six ans, mais rien ne disait qu’elle avait été pleurée.
«Le ciel était brûlant, et, cependant, le sol autour de cette pierre solitaire était humide. Sans doute l’ange de la mort vient de temps en temps verser des larmes sur les tombes inconnues et y secouer son aile pleine de la rosée de l’éternité.
«Mon père avait amené ma mère dans une lointaine contrée de l’Amérique du Sud en me laissant aux soins de quelques bons parents qui m’ont recueilli. Ainsi, mon berceau fut désert ; je n’eus pas une caresse à cet âge même où le premier regard de l’enfant est un sourire ; je puisai le lait au sein d’une inconnue, et, depuis, j’ai grandi, isolé au milieu des hommes, fatigué d’avance du temps que j’avais à vivre, déclassé toujours, ne trouvant rien qui pût m’attacher, ou qui valût quelque souci, de toutes les choses que l’homme convoite.
«J’ai rencontré cependant quelques affections, mais un destin impitoyable les brisait à peine formées. Je ne suis pas fait pour rien de ce qui dure ; j’ai été jeté dans la vie comme une feuille arrachée au palmier du désert et que le vent emporte, sans jamais lui laisser un coin de terre où se trouve l’abri ou le repos. Ainsi j’ai parcouru le monde et nulle part je n’ai pu reposer mon âme accablée d’amertume ; j’ai laissé dans tous les lieux une partie de moi-même, mais en conservant intact le poids qui pèse sur ma vie comme la terre sur un cercueil.
Mes amours ont été des orages ; il n’est jamais sorti de mon cœur que des flammes brûlantes qui ravageaient tout ce qu’elles pouvaient atteindre. Jamais aucune lèvre n’approcha la mienne pour y souffler l’amour saint et dévoué qui fait l’épouse et la mère.
«Pourtant, un jour, j’ai cru, j’ai voulu aimer. J’engageai avec le destin une lutte horrible, qui dura tant que j’eus la force et la volonté de combattre. Pour trouver un cœur qui répondît au mien, j’ai fouillé des mondes, j’ai déchiré les voiles du mystère. Maintenant, vaincu, abattu pour toujours, sorti sanglant de cette tempête, je me demande si j’ai seulement aimé ! Peut-être que j’aimais, je ne sais trop ; mon âme est un abîme où je n’ose plus regarder ; il y a dans les natures profondes une vie mystérieuse qui ne se révèle jamais, semblable à ces mondes qui gisent au fond de l’océan, dans un éternel et sinistre repos. Ô mon Dieu ! cet amour était mon salut peut-être, et j’aurais vécu pour une petite part de ce bonheur commun à tous les hommes. Mais non ; la pluie généreuse ruisselle en vain sur le front de l’arbre frappé par la foudre ; il ne peut renaître... Bientôt, abandonnant ses rameaux flétris, elle retombe goutte à goutte, silencieuse, désolée, comme les pleurs qu’on verse dans l’abandon.
«Seul désormais, et pour toujours rejeté dans la nuit du cœur avec l’amertume de la félicité rêvée et perdue, je ne veux, ni ne désire, ni n’attends plus rien, si ce n’est le repos que la mort seule donne. Le trouverai-je ? Peut-être ; parce que, déjà, j’ai la quiétude de l’accablement, la tranquillité de l’impuissance reconnue contre laquelle on ne peut se débattre. Mon âme n’est plus qu’un désert sans écho où le vent seul du désespoir souffle, sans même y réveiller une plainte.
«Et de quoi me plaindrais-je ? Quel cri la douleur peut-elle encore m’arracher ? Oh ! si je pouvais pleurer seulement un jour, ce serait un jour de bonheur et de joie. Les larmes sont une consolation et la douleur qui s’épanche se soulage. Mais la mienne n’a pas de cours ; j’ai en moi une fontaine amère et n’en puis exprimer une goutte, je garde mon supplice pour le nourrir, je vis avec un poison dans le cœur, un mal que je ne puis nommer, et je n’ai plus une larme pour l’adoucir, pas même celle d’un ami pour m’en consoler.
«Maintenant tout est fini pour moi ; j’ai épuisé la somme de volonté et d’espérance que le ciel m’avait donnée. Ôtez au soleil sa lumière, au ciel ses astres, que restera-t-il ? L’immensité dans la nuit ; voilà le désespoir. Mes souvenirs ressemblent à ces fleurs flétries qu’aucune rosée ne peut plus rafraîchir, à ces tiges nues dont le vent a arraché les feuilles. Je dis adieu au soleil de mes jeunes années comme on salue au réveil les songes brillants qui s’enfuient. Chaque matin de ma vie a vu s’évanouir un rêve, et maintenant je me demande si j’ai vécu. Je compte les années qui ont fui : elles m’apparaissent comme des songes brisés qu’on cherche en vain à ressaisir, comme la vague jetée sur l’écueil rend au loin un son déchiré, longtemps après être retombée dans le sombre océan.
«J’ai mesuré au pas de course le néant des choses humaines, de tout ce qui fait palpiter le cœur de l’homme, l’ambition, l’amour... L’ambition ! j’en ai eu deux ou trois ans à peine : cette fleur amère que les larmes de toute une vie ne suffisent pas à arroser, s’est épanouie pour moi tout à coup et s’est flétrie de même.
En trente ans j’ai souffert ce qu’on souffre en soixante ; j’ai vidé bien au-delà de ma coupe de fiel ; à peine au milieu de la vie, je suis déjà au déclin de ma force, de mon énergie, de mes espérances. Pour moi il n’y a plus de patrie, plus d’avenir !...
«L’avenir ! eh ! que m’importe ! Quand on a perdu l’illusion, il ne reste plus rien devant soi. J’ai souffert la plus belle moitié de la vie, que pourrais-je faire de l’autre, et pourquoi disputer au néant quelques restes de moi-même ? Sur le retour de la vie, quand les belles années ont disparu, l’homme ne peut plus songer qu’au passé, car il voit la mort de trop près ; il ne désire plus, il regrette, et ce qu’il aime est déjà loin de lui. Pour cette nouvelle et dernière lutte, j’arriverais sans force, épuisé d’avance, certain d’être vaincu, tout prêt pour la mort qui attend, certaine, inévitable, pour tout enfouir et tout effacer.
«Non, non, je ne veux plus... je m’efface maintenant que je ne laisse ni un regret ni une pensée. Si, plus tard, quelqu’un me cherche, il ne me trouvera pas ; mais, peut-être qu’en passant un jour près d’une de ces fosses isolées où aucun nom n’arrête le regard, où nulle voix n’invite au souvenir, il sentira un peu de poussière emportée par le souffle de l’air s’arrêter sur son front humide... cette poussière sera peut-être moi...»
8 juin 1874
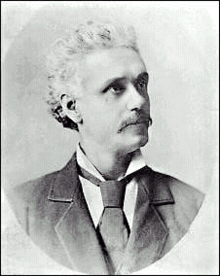
Arthur Buies (1840-1901)

|
|
|
Le courrier
M. August Olofsson - Lahti,
Copenhague 15230
Betty Buehler, Richard Kiley, Otto Hulett, Matt Crowley, Neville Brand, Ernest Borgnine, Walter Klavun, Lynn Baggett, Jean Alexander, Ralph Dumke, John Marley, Jay Adler, Fred Aldrich, Robert Anderson, Charles Bronson, Paul Bryar, Virginia Chapman, Fred Coby, Don De Leo, Frank DeKova, Lawrence Dobkin, Paul Dubov, Jack Finley, Robert
Foulk (1) , Tom Greenway, Kenneth Harvey, Mary Alan Hokanson, Richard Irving, Jess Kirkpatrick, Ethan Laidlaw, Harry Lauter, Charles Marsh, Sydney Mason, Michael McHale, David McMahon, Don Megowan, Al Mellon, Emile Meyer, Art Millan, Dick Pinner, Peter Prouse, William Pullen, Ric Roman et Ernie Venneri.
(1) Un des déménageurs dans Swingin'
Along de Charles Barton (1961).
Mme Joséphine Smallbone, Combpyne,
UK, EX13 9YH
| Brésil |
100,000 |
| Australie |
100,000 |
| Allemagne |
100,000 |
| Russie |
de 150,000 à 200,000 |
| Argentine |
200,000 |
| Royaume-Uni |
300,000 |
| Canada |
de 300,000 à 400,000 |
| France |
500,000 |
| États-Unis |
de 5,000,000 à 6,000,000 |
| Israël |
6,000,000 |
|
|
| Total |
Entre 14,500,000 et 15,000,000 |

|
|
|
Dédicace
Cette
édition du Castor est dédiée à :

Joe E. Brown
(1891-1973)

|
|
|
Le mot de la
fin
Ou plutôt, aujourd'hui, la question du
jour :
«Pourquoi les hiboux
ne font pas partie de notre alimentation ?»
Et sa suite :
«Maintenant, essayez de
ne plus y penser.»
- Sam Harris (Du libre
arbitre)

|
|
|
Autres sites à
consulter

Webmestre : France L'Heureux

Webmestre : Éric Lortie

Webmestres : Paul Dubé et Jacques Marchioro
|
|
|
Notes et autres avis
Clauses et conventions :
Le Castor™ de
Napierville est le fruit de plusieurs interventions de la part d'une
multitude d'intervenants :
-
En tête, son
programmeur qui a pour tâche de transformer son contenu en
fichiers HTML de telle sorte à ce qu'il puisse être diffusé en
textes lisibles sur Internet
-
En arrière-plan,
son éditeur qui réunit dans un ordre pré-établi les textes et
images qui en font parti
-
Les chroniqueurs,
chercheurs, concepteurs qui en rédigent chaque numéro.
-
Viennent ensuite
les correcteurs, vérificateurs, inspecteurs et surveillants qui
en assurent la qualité.
mais d'abord et avant
tout :
Autres informations,
conditions et utilisation
Le Castor™ de
Napierville est publié une fois par mois, le premier lundi de chaque
mois.
En haut, à gauche, à côté
de la date, est indiqué le numéro de sa version ou de son édition. Le
numéro1.0 indique sa première et suivent, selon les correctifs, ajouts
ou autres modifications, les numéros 1.2, 1.3, 1.4.... 2.0, 2.1, 2.2
etc. - La version 3.0 indique qu'il s'agit de son édition finale qui, généralement,
coïncide avec sa version destinée au marché américain, celle qui
paraît en principe avant ou le jeudi suivant sa première édtion.
Si le Castor™ de
Napierville a un siège social, il n'a pas de salle de rédaction et
compte tenu de la situation géographique de chacun de ses
collaborateurs, tout le ci-dessus processus se déroule in auditorium
c'est-à-dire en présence du public via l'Internet.
Nous prions nos lecteurs,
etc.
Historique :
Fondé en 1900 par le Grand Marshall, le CASTOR DE NAPIERVILLE fut, à l'origine, un hebdomadaire et vespéral organe créé pour la défense des intérêts de l'Université de Napierville et de son quartier. - Il est, depuis le 30 septembre 2002, publié sous le présent électronique format afin de tenir la fine et intelligente masse de ses internautes lecteurs au courant des dernières nouvelles concernant cette communauté d'esprit et de fait qu'est devenu au fil des années le site de l'UdeNap, le seul, unique et officiel site de l'Université de Napierville.
De cet hebdomadaire publié sur les électroniques presses de la Vatfair-Fair Broadcasting Corporation grâce à une subvention du Ministère des Arts et de la Culture du Caraguay, il est tiré, le premier lundi de chaque mois, sept exemplaires numérotés de I à VII, sur papier alfa cellunaf et sur offset ivoire des papeteries de la Gazette de Saint-Romuald-d'Etchemin et trois exemplaires, numéroté de 1 à 3, sur offset de luxe des papeteries Bontemps constituant l'édition originale, plus trois exemplaires de luxe (quadrichromes) réservés au Professeur Marshall, à Madame France DesRoches et à Madame Jean-Claude Briallis, les deux du Mensuel Varois Illustré.
Autres informations :
1 - Sauf indications contraires : Tous droits réservés. - Copyright © UdeNap.org. - La reproduction de tout ou partie du matériel contenu dans cette édition du Castor™ est interdite sans l'autorisation écrite des auteurs.
2 - Malgré l'attention portée à la rédaction de ce journal, ses auteurs ou son éditeur ne peuvent assumer une quelconque responsabilité du fait des informations qui y sont proposées.
3 - Tel que mentionné ci-dessus : les erreurs de frappe, de date et autres incongruités contenues dans ce Castor™ seront ou ont déjà été corrigées dans sa version destinée au marché américain.
4 - La direction du Castor™ tient à préciser qu'aucun enfant n'est victime d'agressions sexuelles au cours de la préparation, pendant la rédaction et lors de la publication de son hebdomadaire.
 . .
|
| |
Liens :
Le Castor™ - Index (2018, 2019, 2020)
Le Castor™ - Fondation et équipe originelle
Le Castor™ - Organes affiliés
*
Le Castor™ - Édition précédente
Le Castor™ - Édition suivante
Le Castor™ - Édition courante

|


 Simon Popp
Simon Popp
 Herméningilde Pérec
Herméningilde Pérec

 Copernique Marshall
Copernique Marshall
 Jeff Bollinger
Jeff Bollinger
 Georges Gauvin
Georges Gauvin
 Fawzi Malhasti
Fawzi Malhasti
 De notre disc jockey - Paul Dubé
De notre disc jockey - Paul Dubé