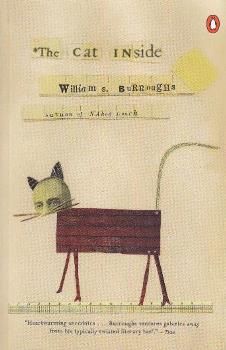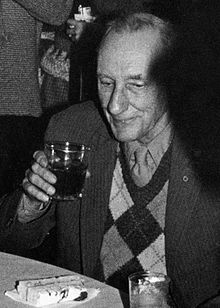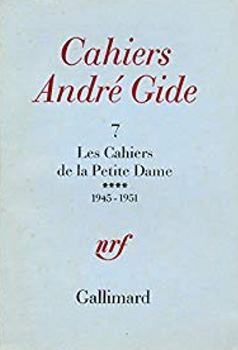|
|
Pour les chroniques précédentes de nos correspondants
cliquez sur
ce lien .
|
|
|
 Simon Popp
Simon Popp
Une, deux, trois
Mes chroniques, aujourd'hui, sont au
nombre de trois auxquelles j'ai ajouté, dans ce qui est devenu un
fourre-tout, d'autres capitalissimes réflexions que j'accumule dans un symbolique
fond de tiroir.
Un seul ennui : on m'a
imposé pour deux de ces chroniques des thèmes à propos desquels je
n'ai, à toutes fins utiles, aucune connaissance, ce qui n'a pas posé
trop de problèmes à mon éblouissante imagination car, plutôt que de
consulter à droite et à gauce, et être ainsi obligé de me faire une
idée, j'ai décidé tout simplement de me servir de ces deux occasions pour
aligner dans un délirant optimisme des questions en espérant que ceux
qui connaissent ce dont j'avais à parler désireraient y
répondre. Le
premier de ces énigmatiques thèmes est celui de la solitude sur lequel je
dois avouer que je ne connais
que ce qu'on m'en a dit ou ce que j'ai appris en écoutant quelques chansons. Le
deuxième est celui de l'éducation ou des systèmes d'éducation
que je persiste, parce qu'ils me semblent si mauvais, à appeler des
systèmes d'éducationnement, un mot qui rime étrangement avec le
mot enrôlement. Le
toisième m'est venu spontanément à l'esprit après avoir lu un texte
sur le refus ou l'acceptation d'André Gide au Québec et ce dans le cadre d'un
immense plongeon que j'ai fait depuis quelques semaines dans les écrits
de cet auteur dont - autant vous le dire tout de suite - j'ai toujours
admiré la langue mais pas les opinions. Ni le style de vie. - J'en
reparle d'ailleurs dans la section «Notes de lecture» du présent
Castor™. Alors... Si
on ne vous l'a pas encore dit : Bonne
lecture ! Simon
*
La solitude
Mon correspondant, toujours le même, celui qui habite en face du
Parc Lafontaine à Montréal, nous a demandé, à nous du Castor™,
il y a un temps de cela, de
lui parler de, semble-t-il, un mal qui se répand de plus en plus dans
nos grandes villes, d'où cette prolifération de quartiers artificiels,
d'immeubles de rapport «au caractère unique», d'«oasis au
coeur de la ville» et surtout de maisons de retraite où il faut
bon de se retrouver entouré de gens de sa génération... - De la solitude, quoi.
Deux chansons me sont revenues en tête quand j'ai finalement eu le temps de penser à cette affreuse période de la vie où,
apparemment, l'on se retrouve, comme la grand-mère de Proust, «bien
seul». La première est évidemment, le cri lancé par Léo Ferré dans les années soixante-dix,
à un moment où il s'est cru plus génial que génial et qui ne mérite pas d'être cité. La
deuxième, sans être, une panacée fournit à ceux qui ne sont pas encore
seuls une lueur d'espoir. Elle est de Moustaki (Georges) :
Pour avoir si souvent dormi
Avec ma solitude
Je m'en suis fait presque une amie
Une douce habitude
Elle ne me quitte pas d'un pas
Fidèle comme une ombre
Elle m'a suivi çà et là
Aux quatre coins du monde
Non, je ne suis jamais seul
Avec ma solitude...
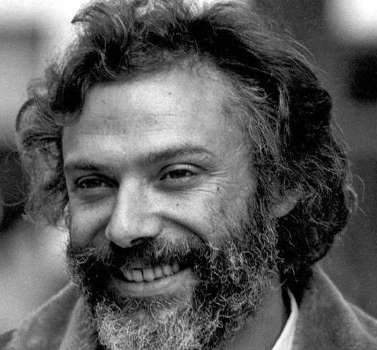
Georges Moustaki
J'ai dit «lueur d'espoir» car si je me fie à ce que je vois
autour de moi, il semblerait que la solitude accompagne irrémédiablement
ce temps alloué à un homme ou une femme, à l'automne de leurs jours,
où il leur est enfin permis de faire ce dont ils ont rêvé pendant des
années sauf que, et c'est là une chose que j'ai remarqué trop
souvent, notamment chez mes collègues, rares sont ceux qui, lors de
leur retraite, ont donné suite aux engagements qu'ils ont pris
envers eux-mêmes de voyager, lire, aller au théâtre ou même
s'adonner au jardinage ou à une certaine activité pédestre dans des
sentiers boisés. La plupart finissent par ne rien faire du tout sauf se
plaindre que le temps passe trop vite, ce temps qu'il disperse dans une
routine quotidienne qui consiste à se lever, manger, regarder la télé (chaîne météo) et
s'endormir après avoir maugréer contre les taxes, la politique et le
nombre croissants des
catastrophes que l'on diffuse tous les soirs lors d'un ultime bulletin de nouvelles.
Remarquez que ce n'est pas mauvais comme style de vie. C'est quand même, mieux, à mon avis, que
ces activités pour gens du troisième âge, activités gratuites,
mais moyennant un léger supplément, qu'on affiche sur les babillards des
résidences de gens qui n'ont pas encore appris qu'il n'y en a pas de quatrième
âge : visite de l'Oratoire, danses en ligne, cours de macramé, conférences
sur l'alimentation, gymnastique pour aînés... autrement dit - et c'est
là le comble de
l'horreur - à se désennuyer en compagnie de gens de son âge - dont
certains avec marchettes - avec qui on n'a, faute
des circonstances de la vie, rien en commun. Que dire à un bonhomme assis à
ses côtés dans un autocar adapté, qui a tenu
une quincaillerie toute sa vie et qui a suivi les Canadiens pendant des décennies
ou à une dame qui a eu six enfants quand on en n'a eu aucun et qu'on a été
comptable ?

L'Oratoire
Il me semble y avoir dans ce genre d'occupations planifiées pour des
gens qui ont déjà vécu la majeure partie de leur vie, une tentative de
les retourner dans un semblant de bon vieux temps où tous les gens
étaient voisins, se fréquentaient en famille, ne se disputaient pas
entre eux, s'entraidaient, étaient heureux... - Mais ce bon vieux temps,
je l'ai connu et s'il y a une chose que je souhaite par dessus tout, c'est
qu'il ne revienne jamais.
Peut-être que je me trompe, mais je crois que la vieillesse idéale
est celle où, justement, l'on peut, enfin, vivre seul, lire ce qui nous plaît,
regarder Bug Bunny à la télé sans avoir à rendre compte à qui que ce soit,
de quoi que ce soit, surtout pas de ses habitudes
alimentaires, ni des heures auxquelles il nous plaît de dormir.
D'ailleurs plus ça va, plus je m'aperçois que mes
idées, mes opinion, mon vocabulaire même et la façon dont je
m'exprime sont d'un autre âge et qu'ils forment autour de moi une sorte
de bulle que la nature, dans sa sagesse, me fournit pour me protéger
contre ces envahisseurs qui tiennent absolument à ce que je m'embête
à ne pas être seul.
Ah ! Ramenez-moi le temps où l'on casait le vieillard que je suis en
train de devenir dans une chaises
berçante près de la cuisinière. Ça ne peut pas être pire que ce qu'on
m'on offre en ce moment.
Et attendez ! Je ne vous ai rien dit encore des veuves qui me courent après...
La solitude ? - Connais pas. Ou plutôt si : une béatitude quand on
finit par l'apprivoiser.
***
Éducationement et
ignoranteté
Il est plus que certain - et vous comprendrez cette introduction dans
deux minutes - que je vais me tromper en disant que l'éducationnement,
aujourd'hui, n'a aucun rapport avec la réalité. - J'avance cela en me
basant sur deux principes :
Un : mon père l'a affirmé avant moi et mon grand-père
l'a affirmé avant lui : les générations qui nous suivent sont à la dérive.
et
Deux : ce premier principe découle du fait que les grands-pères
ont généralement mal éduqué leurs fils et futurs pères, et que ces
pères ont généralement mal éduqué leurs enfants.
- Personnellement, je peux vous affirmer que mon père m'a mal éduqué et que
je n'ai pas servi d'exemple à ceux qui étaient à ma portée.
(On comprendra que pères et grands-pères, dans les
phrases qui précèdent, sous-entendent mères et
grands-meres et ajoutez, si vous le voulez : professeurs,
enseignants ou toutes personnes servant à éducationner la jeunesse.)
La raison pour laquelle je me permets d'avancer ces deux points se résume
à un mot : l'expérience. - Mon père et son père me donneraient
raison là-dessus. - Ce qui efface d'un seul trait le contenu de mon
premier point, car lorsque mon grand-père regardait mon père et
que mon père me regardait et qu'ils, le premier, mon père et le
second, moi, ils avaient que partiellement raison car nous étions à ce
moment-là des adolescents sauf que :
Je suis peut-être bouché à l'émeri, mais plus je les regarde,
plus je me dis que les ados d'aujourd'hui, sans doute plus éduqués
(entre guillemets, sv.p., Monsieur l'éditeur), sont convaincus d'en
savoir plus que tous ceux qui les ont précédés ; une conséquence
sans doute du présent système d'éducationnement qui se donne comme
but de leur supprimer toute la curiosité qu'ils pouvaient avoir avant
de s'asseoir sur un banc d'école (Voir la
note à la fn). - Comment, dans ces conditions leur apprendre quoi que
ce soit ? - Je ne sais pas, moi, tenez : les bienfaits de la discipline,
de la politesse, des bonnes manière, ou même du travail...
C'est d'ailleurs - entre parenthèses - pourquoi le Professeur s'est toujours entouré de jeunes :
«Ils connaissent tout, répète-t-il souvent. Cela m'évite
des heures de recherches.»

Photo en provenance de la revue Belphégor
Finalement, un dernier point préambulatoire :
Avec l'âge, quand je parle de la génération qui me
suit, je la confonds invariablement avec l'autre après. Ainsi quand je
dis la génération qui me suit, je pense plus à la génération
qui suit ma génération, n'ayant pas oublié, quand même, que
lorsqu'elle avait l'âge de la génération montante, la génération
qui me suivait n'était pas plus brillante.
Bon, tout ça étant dit, je dois avouer que je n'ai aucune idée
ce à
quoi peut servir l'éducationnement, tel ou telle qu'on le ou la
pratique aujourd'hui.
Jadis, du temps de mon grand-père, l'éducation - la vraie - servait essentiellement à
enseigner aux jeunes comment lire et écrire ; à compter également. Après, venait le véritable
apprentissage de la vie : on mettait ces jeunes en apprentissage (c'est le cas
de le dire) chez un imprimeur, un bijoutier, un forgeron ou un cuisinier
où on leur enseignait un métier, c'est-à-dire de quoi gagner
leur vie.
Du temps de mon père. l'apprentissage commençait un peu plus tard
car l'on avait des cours à suivre pour obtenir un permis ou du moins
une certaine connaissance technique avant d'être promus boucher,
plombier, chauffeur d'autobus ou arpenteur-géomètre. - Hé ! On
exigeait même un diplôme de neuvième pour être accepté dans la
police...
De mon temps, l'enseignement durait plus longtemps : on nous aprenait
l'histoire, la géographie, la géométrie et, si l'on était privilégié,
le latin, le grec ou les deux, - C'était pour le bon motif : celui de
nous apprendre à vivre en groupe (lire : en société). - Enfin, c'est
ce que j'ai cru comprendre. - Après, encore une fois, on choississait une occupation qui
allait nous permettre de - j'insiste - gagner notre vie et même de faire
carrière dans un domaine ou un autre : celui de l'alimentation, de
l'assurance, des finances et même la bibliothéconomie.
Aujourd'hui, je ne sais pas. D'après ce que j'ai pu comprendre, l'on
choisit son métier ou sa profession selon ses talents, ses goûts ou son
caractère grâce à des spécialistes en «orientation» et en très
bas âge d'après ce qu'on m'a dit. - Et c'est là que j'en arrive aux informations qui suivent :
Les offres d'emploi qui demeurent sans réponse et la pénurie de
main-d'oeuvre dans divers domaines :

La construction
C'est un fait notoire qu'il faudrait 300 000 nouveaux travailleurs
uniquement dans ce domaine, ne serait-ce qu'au Canada, pour
combler les départs à la retraite d'ici 2023.
Les transports
Il manquerait 52 000 nouveaux manipulateurs, camionneurs, préposés à la
livraison d'ici quatre ans pour maintenir la situation telle
qu'elle est en ce moment et qui croît de 15 à 20% annuellement depuis cinq ans.
Le secteur manufacturier
Les Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) estiment
dans une proposrtion de 52% que le manque de soudeurs, de
machinistes, de métallurgistes et d'opérateurs de machineries
diverses les empêche
d'augmenter leur productivité
Les techniques informatique
6 000 postes demeureraient présentement à être comblés dans le
domaine de la simple collecte et numérisation de données
L'agriculture
Le taux d'emplois agricoles vacants s'élève présentement
à 7%, soit le taux le plus élevé au Canada, toutes industries
confondues
Permettez que je passe par dessus des secteurs comme les soins infirmiers,
la technologie, le commerce (assurance bourse, banque, etc.) où des
centaines de milliers de dollars sont investis depuis plusieurs années
pour attirer et former des candidats.
Et puis un paradoxe (tant qu'à y être) : alors que le Canada forme des physiciens de classe mondiale au niveau du doctorat, une pénurie de techniciens et d’ingénieurs d’application entrave la croissance de l’industrie.
Évidemment, dans tous ces secteurs, la gloire, la créativité
personnelle, la réalisation de son soi ne font pas partie des critères
lors de la sélection parmi ceux qui y présentent leur candidature, ni,
la plupart du temps ses talents, goûts ou son caractère car, qui à
vingt ans, rêve de devenir courtier en assurances, gérant d'une
succursale bancaire, ou revendeur de panneaux décoratifs en
aluminium pour pavillons de banlieue ?
Mais qui a dit que le travail devait être uniquement à sa mesure
et... plaisant ?
Question :
Est-il possible, à long terme, qu'on retourne aux principes de base
de l'éducationnement (à moins que je me trompe) : celui de gagner sa
vie d'abord et avant tout ?
Un caveat :
Il me faut quand même avouer une chose : que les jeunes
d'aujourd'hui sont quand même débrouillards et ont su créer des débouchés
dans des secteurs que nous ne pouvions pas nous imaginer quand nous
avions leur âge. - Qui, par exemple, aurait cru qu'on pourrait ouvrir
son propre salon de tatouage en 2019 ?
Et une note, pour terminer (à propos de la curiosité) :
Une récente étude effectuée en Angleterre a déterminé que, règle
générale, les jeunes enfants (moins de six ans) posaient jusqu'à 300
questions par jour, se tournant la plupart du temps vers leur mère,
c'est-à-dire une question à toutes les deux minutes et demi. - Cette
situation diminuait presque instantanément dès qu'ils se mettaient à
fréquenter l'école.
(Ce qui n'a surpris personne à l'Université de Napierville où l'on
a noté que dès la fin de leurs études secondaires, la curiosité chez
les élèves était complètement disparue.)
Les deux questions les plus souvent posées par ces jeunes en bas âge
:
- Pourquoi l'eau est-elle humide ?
- De quoi sont faites les ombres ?
Et une dernière remarque :
Heureusement, comme disait Lady Bracknell dans The Importance of
Being Earnest d'Oscar Wilde : le système d'éducation n'a aucun effet
sur la jeunesse.
* **
De la religion
(Et plus particulièrement, de la religion catholique au Québec)
Je viens de terminer la lecture d'un texte de Jacques Cotman, un critique, historien et bibliographe qui a enseigné à l'université York de Toronto de 1964 à 2003,
un texte publié chez Gallimard en 1972 dans le numéro 3 des
Cahiers d'André Gide («Le Centenaire») sous le titre de : «Refus et acception d'André Gide au Québec».
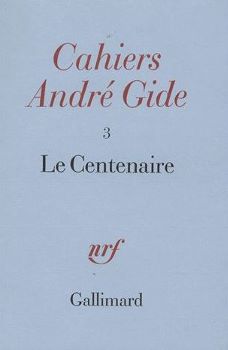
Cette lecture,
je l'ai faite alors que j'étais à mi-chemin de mes «corrections d'épreuves»
(voir note 1 à la fin)
et que je suis toujours en train de faire d'un autre texte (un livre) de Robert Mallet, connu pour ses entretiens avec Paul Léautaud,
dont le titre est «Une mort ambigüe», publié en 1955 également chez
Gallimard, et qui traite de la publication de la correspondance entre Paul
Claudel et Gide particulièrement du point de vue de Gide. Peu s'en fallu pour que j'aille à mon ex-bureau récupérer les quatres volumes des «Cahiers» précités rédigés par celle qu'on a appelé «La petite dame» et qui, voisine de Gide, a tenu pendant
plus de trente ans un journal des faits et gestes de son voisin jusqu'à sa mort en 1951. [Longue
phrase : à corriger. - Note de l'éditeur.]
(Pour ceux qui ne le savent pas, cette «petite dame» fut Madame Maria Van Rysselberghe, l'épouse du peintre Théo et la mère d'Élisabeth avec qui Gide eut une fille du nom de Catherine en 1923. Cette Catherine,
qu'on se le dise, est décédée en 2003 à l'âge de 90 ans.)
Dans l'ensemble, ces textes, lectures et relectures (en partie) - voir à la fin, encore - m'ont particulièrement rappelé ce qui est arrivé à l'Église catholique au Québec avant, pendant et après ce qu'on a appelé la «Révolution tranquille», au
vrai début de laquelle je suis né, «Révolution» qui a eu cent points de départ et mille points d'arrivée.
Car on dit, à tort d'ailleurs, qu'elle s'est déroulée de 1959 jusqu'en 1970. Mais non : elle était là, en puissance dans les années quarante,
notamment au moment du retour de ceux qui avaient combattu lors de la dernière Grande Guerre
; et quiconque a connu et entendu l'archevêque Paul-Émile Léger à son retour du Vatican où il fut élu cardinal en 1953 ou
porté attention à certaines conversations en famille dans les années
cinquante pourra vous le confirmer pour ce qui est des années qui ont
précédé 1959. Quant à l'expression elle-même, on ne sait, au juste, qui l'a créée
ni quand. Certains avancent qu'elle est apparue pour la première fois dans le
Globe and Mail de Toronto, ce qui me paraît paradoxal.
Quoiqu'il en soit, LA conséquence la plus marquante de cette Révolution, fut et demeure, à mon avis, la presque totale disparition de l'influence de l'Église sur la société québécoise, disparition d'autant plus remarquable qu'elle a donné lieu à des modifications dans les prises de position politiques, économiques, éducationnelles et même sociales dans à peu près toutes les régions du Québec, prises de positions qu'on
ne saurait pourquoi, de nos jours, il faudrait imposer ;
l'ouverture des commerces le dimanche,
l'abandon ou presque de la prière au début des réunions politiques,
la disparition des enseignants religieux, transformation des hôpitaux gérés par des
laïques en des établissements non seulement non-religieux,
mais non-laïques, etc..
Oh, je ne dis pas que les Québécois sont devenus anti-religieux, mais les statistiques
(note 2) démontrent
que, depuis 1970, ceux qui se disent de foi catholique, se déclarent non-pratiquant à raison de dix pourcent
de plus par décennie. Faites le calcul : 100% en '70, 90% en '71,
81% en '72, etc. Et cela ne tient pas compte de ceux qui le sont devenus dès 1960. - Cela se réflète sur le nombre de prêtres (8,400 en 1981, 4,285 en
2005), le nombre de paroisses (1,852 en 1995 [sic], 1,717 en 2003). -
Et je lis depuis quelque temps que : le taux de fidèles allant à la messe le dimanche est présentement de 33% ; près de 6 québécois sur 10 sont en faveur d'une chartre de laïcité ; seulement 59% des nouveaux parents ont fait baptisé leur enfant en 2010
(*) ; 91% des québécois croient que l'avortement devrait être permis, minimalement dans certaines circonstances, et 54% dans toutes circonstances ; entre 70 et 80% sont favorables à l'euthanasie et au suicide assisté...
(*) La Presse rapportait dans son édition du
10 mars dernier que le nombre de baptêmes était passé de 42,213 en
2012 à 30,394 en 2017 (v. 83,900 naissance ou 36%). - Une baisse de
28%.

Et pourtant :
On voit encore - je vois ! - de véritables non-pratiquants faire encore baptiser leurs enfants, des cérémonies quasi religieuses lors de décès ; des mariages célébrés dans des églises, des funérailles dites «nationales» qui
se déroulent dans des endroits [de culte] «mythiques» où, de plus en plus, les visiteurs sont des touristes... payant.
Hé : j'assiste régulièrement à des bénédicités et à des discussions où ceux qui se déclarent non-croyants se font regarder de travers...
Quousque tandem... Jusques à quand cela durera-t-il ?
Question : la religion catholique deviendra-t-elle éventuellement
une manifestation folklorique ou un rappel historique (comme le crucifix
à l'Assemblée Nationale ?
Une citation (elle est de Gide et est cité par Robert Mallet dans le livre mentionné ci-dessus).
- Comme d'habitude : aucun rapport avec ce qui précède :
«Pour moi, le Christ est la figure la plus authentiquement admirable. Mais j'ai pris en horreur les faux pasteurs, les exégètes, les édificateurs de dogmes qui croient avoir le monopole du vrai et qui n'ont fait que l'étriquer ou le fragmenter.»
Que voulez-vous que j'ajoute de plus ? - Que l'islamisime est à nos portes ?
Une chose quand même :
Le discours - je n'ose pas écrire «dialogue» - entre les croyants
et les non-croyants a beaucoup évolué depuis les années cinquante
quand trois «vieillards», comme les appella Mallet quand il écrivit
son livre, (Gide a alors 81 ans, Claudel 82 ans et Léautaud 78 ans),
discutaient, à leur époque, de la mort ou de l'existence ou la non-existence de Dieu.
C'est que la science a fait d'immenses progrès depuis ou plutôt
qu'elle s'est répandue dans le monde non-scientifique à une vitesse
foudroyante. Avec la télévision entre autres, où l'on saisit la
simultanéité
d'événements
qui se produisent sur notre planète
et... l'Internet. - Qui persiste à croire encore, de nos jours, que le
monde a été créé en six jours, il y a moins de dix mille ans ? que
la «théorie» de Darwin n'est qu'une théorie au sens restreint
?- Oui, je sais : plus de 50% de la population américaine (américaine !), mais moins de dix pourcent des Suédois...
C'est Sam Harris (je crois) ou Christopher Hitchens (sans doute) qui
a rappelé que la non-croyance en Dieu était une chose si dérangeante
pour les croyants qu'ils ont cru nécessaire d'inventer un mot pour en décrire
les adeptes : «Les athées», le mot «sceptiques» n'étant, à
leurs oreilles, pas assez «provocateur». - «Pourtant,
disait-il, on n'en a inventé aucun pour décrire ceux qui ne croient
plus aux horoscopes ou à l'alchimie...» - «Je ne suis pas un athée :
je suis de ceux qui ne sont pas déistes» dit et redit Sam Harris
lors des débas auxquels il participe.
Personnellement - et cela n'engage en rien l'opinion des membres du
Castor™ et encore moins celle des dirigeants de l'Université de
Napierville - je qualifierais les «athées» d'aujourd'hui de «ceux
qui n'acceptent pas les dieux (au pluriel) tels que définis par
ceux qui les ont visiblement conçus par l'intermédiaire d'une religion
quelconque (ou non).» Et j'ajouterais : «... et particulièrement
par ceux qui se targuent de connaître leurs (encore une fois au
pluriel) natures et ordonnances parce qu'ils ont lus et compris le
contenu de livres anciens supposément dictés par leurs divinités,
quelles qu'elles soient.»
Et Gide dans tout ça ?
Ben, comme vous le verrez un peu plus loin dans cette édition du
Castor™, on n'en parle plus. - D'ailleurs, comme je vous
l'expliquerez, je ne vois pas pourquoi on en parlerait.
*
Note 1 - «Correction d'épreuves» - C'est
l'expression que j'utilise pour décrire le travail qu'implique la vérification
et le reformatage d'un texte obtenu en digitalisant (scan) les
pages de, par exemple, un livre, et en transformant les images ainsi
obtenues en textes que l'on peut amender via un logiciel
(j'utilise Omnipage depuis des années). - C'est une opération qui
permet, une fois qu'elle est terminée ; 1) de lire ce texte sur un écran
ou une tablette et, surtout : 2) d'y effectuer des recherches. - Le
temps ? Du début à la fin, environ quatre à cinq fois le temps de lire au départ
le texte à digitaliser. - Mais ça en vaut la peine. - C'est sûr que les
textes déjà disponibles sur Internet ou qu'on peut se procurer
commercialement n'ont pas besoin des opérations précitées, mais
dans certains cas, cela s'impose. Celui mentionné
ci-dessus par exemple.
Note 2 - Les chiffres mentionnés dans cette chronique peuvent
facilement être obtenus sur divers site. Suffit de taper «religion»,
«catholicisme», «Québec» (etc.) dans n'importe quel
fureteur. - Merci à Jeff pour les informations citées ci-dessus.
P.-S. : On m'informe que la ville de Montréal retirera sous peu le crucifix qui trône présentement
dans sa salle de conseil et que le Gouvernement du Québec songerait à faire de même
en son Salon bleu, celui de l'Assemblée nationale... (Sous peu... soit au cours des travaux de
réfection qui dureront trois ans.) - Yeah, sure.
***
Fonds de tiroir
Un :
Je ne sais pas si c'est la vieillesse ou la
lassitude d'avoir à écouter huit opinions sur un événement qui a fait la
une du téléjournal de vingt heures la veille ou celui de huit heures du
matin, mais je trouve de plus en plus singulier - j'allais écrire «curieux»
sauf que rien dans tout ce qui suit me semble digne de piquer une certaine
curiosité - qu'on puisse attacher une importance à ce qui dans deux jours
deviendra un fait divers.
Comme je le faisais remarquer à une amie
au cours d'une rencontre il n'y a
pas très logtemps, il est rare que dans une vie humaine quelque chose de
vraiment capital se produise, quelque chose qui marquera l'histoire pour des
siècles à venir. L'exemple que j'aime à donner, avant que ceux qui étaient
là quand c'est arrivé, disparaissent complètement, est l'assassinat du Président
Kennedy qui a fait l'objet de discussions sans fin pendant des mois au sein de
la poupulation de ma génération et qui, pour la génération des
vingt-vingt-cinq ans d'aujourd'hui est devenu un fait divers. Alors, si vous
pensez que la démission d'une députée, le véto d'un président à propos
d'un mur sans importance ou l'annonce qu'un maire serait atteint d'un cancer
- et de la prostrate par dessus le marché - va me faire sortir de ma
stupeur...
Avis est donné aux intéressés : je ne suis
pas né sous le régime de Duplessis (allez faire comprendre cela bonhomme qui
s'intéresse présentement au Brexit), mais bien sous celui d'Adélard
Godbout....

Adélard Godbout
(1882-1956)
... alors que Pie XII était pape et un peu plus de trois mois après
que le futur Cardinal Léger (natif de Sallaberry-de-Valleyfield au cas où
vous ne le auriez pas) soit élevé au rang de Monseigneur à 38 ans, le
même qui fut un des clients les plus réguliers du Grand Véfour à Paris
alors qu'il était missionnaire au Cameroun.
Et je viens d'apprendre en écrivant ce qui précède
que deux roquettes auraint été lancées de la bande De Gaza vers la région de
Tel -Aviv. Oyoye !
*
Deux :
On me donne souvent dix ans de moins que j'en ai. «Oui, je m'empresse souvent de préciser
: dix ans de moins, mais un dix ans très fatigué alors que j'en ai en réalité dix ans de plus,
quoique relativement en santé - et si ce n'était que de monter et descendre des escaliers ou me pencher, ce serait vingt ans qu'il faudrait ajouter à celui que vous voyez.»
Il y a quelque temps, j'ai dit à une jeune dame - je dis bien «une jeune dame» et non «une feune fille» (depuis qu'il s'est fait couper les cheveux) - que..
s'il elle avait dix ans de plus et moi, trente ans de moins... Mais je me suis empressé
d'ajouter : «Sauf que ça ne fonctionnerait pas plus !»
Ce qui me fait penser :
Quand il m'arrive de regarder des albums-photos des années cinquante, particulièrement ceux du début des années cinquante ou
même de la fin, albums qui contiennent des clichés de premières communions, de baptêmes et de mariages (c'est ce qu'on photographiait le plus à l'époque), je suis toujours étonné de constater que les
vieillards qui s'y trouvent, en pères, grand-pères ou oncles (ce qui n'exclut pas les mères, grands-mères et tantes),
n'ont que cinquante et rarement plus que soixante ; qu'on y retrouve rarement des gens qui ont aujourd'hui mon âge sinon, parfois, en fauteuils-roulants ou fortement
supportés par d'autres plus jeunes qu'eux. C'est troublant.

Simon

|
|
|
 Herméningilde Pérec
Herméningilde Pérec
Circulaires,
publi-sacs,
La boutade de
Simon dans ses «Fonds de tiroir» du précédent numéro du
Castor™, car c'en était une, à savoir qu'il... - Laissez-moi
d'abord la citer au complet :
«J'hésite beaucoup à donner de l'argent aux mendiants
qu'on rencontre de plus en plus dans les rues des grandes villes. - Dieu
sait ce qu'ils feront de mon aumône. Dans le lot, je suis certain qu'il
y en a qui l'utiliseront pour faire imprimer leur CV et se trouver un
emploi, privant ainsi un fils d'une bonne famille d'une source de revenus qui
lui était destinée.»
... en a fait
sourire plusieurs, mais également réfléchir autant d'autres. Mademoiselle
G*** de l'établissement B***, de même que sa collègue Y***, endroit
que je fréquente pour un léger problème de santé (à mon âge...)
m'ont dit qu'elle l'avait fait réfléchir, par sa «contre-vérité»
(quoique ce n'est pas le mot qu'elles ont utilisé), aux ferendae
sententiae societatis (idem) c'est-à-dire aux modes de pensée
imposées par la société qui stipulent, dans ce cas précis, que tous
les citoyens d'une grande ville doivent se sentir coupables de ne pas
s'occuper de l'itinérance et des gens qui, pour une raison ou pour une
autre, en ont fait un mode de vie. «Qu'est-ce que je dois répondre,
me demanda Mademoiselle G***, à un type - vous le connaissez,
il est toujours en face du [ici un endoit que je ne peux pas citer]
qui est visiblement intelligent et en santé, ne cesse d'harceler
tous les passants, jour après jour comme si on lui devait
quelque chose ?» - Et d'Y*** de renchéchir : «Et vous avez vu
comment il est habillé ? Il porte des vêtements que je
ne peux même pas me payer !» D'autres
exemples ont suivi ce cas unique, mais par la suite, j'yy ai songé et
presque immédiatement je me suis souvenu d'un autre du même acabit
qui, rue *** près du couvent des Ursulines où j'ai une bonne amie,
lorgne régulièrement ma serviette de cuir, un cadeau de Madame Pérec,
une serviette qui a plus de vingt ans et dont je suis fier de la
patine... - Et j'ai pensé que si, l'on faisait un sondage auprès de
nos lecteurs que plusieurs n'auraient aucune difficulté, de citer, en
catimini, des exemples semblable. - Ce qui m'a amené à témérairement
penser ceci : Quelle
est la logique qui nous pousse, nous, humbles citoyens qui vaquont pour
la plupart à nos affligeantes occupations en toute humilité, à nous
sentir coupables devant des faits qui nous sont imposés souvent par
des individus à qui nous ne demandons rien et dont - dans le cas de
l'itinérance - plusieurs organismes existent pour leur venir en aide
et auquel - encore là, on nous a pas demandé notre avis - nous
devons financièrement participer d'une façon directe ou indirecte. «Primo
et principalita caritas» me direz-vous et vous aurez parfaitement
raison. D'ailleurs, je ne saurais par où commencer pour m'occuper des
itinérants de mon propre quartier, encore moins de ceux de la
municipalité où j'habite. - Il s'agit là d'un problème social qui
me dépasse, comme la plupart des problèmes sociaux modernes. - Je
suis, on me le rappelle tous les jours, d'un temps presque ancien. mais
il est un situation que j'ai beaucoup de difficultés à accrpter :
c'est celle des sacs de feuillets publicitaires qu'on dépose régulièrement
devant ma porte malgré l'affiche que j'y ai apposée pour les
interdire.

H. Pérec

|
|
|
 Copernique Marshall
Copernique Marshall
Johnny Come Late
J'aurais voulu, pour cette édition, vous parler d'un
livre d'articles paru en 2011 de Christopher Hitchens, Arguably,
que j'ai lu au cours de mes récents déplacements, mais, comme
d'habitude, toujours à la dernière minute, j'ai remis ma copie au moment
où l'éditeur était en train de s'arracher les cheveux à la lecture des
chroniques de Simon qui semble n'avoir eu rien d'autres à faire le mois
dernier sauf lire et écrire.
«C'est que, m'a dit l'éditeur, le bougre les
a emboités les unes dans les autres et tenter d'en retirer une pour le
mois prochain, c'est comme retirer une pieuvre d'un baril de pieuvres.»
Ayant voulu l'aider, je les ai lues, l'une après
l'autre, pour réaliser qu'on pouvait, à quelques détails-près, les
lire dans n'importe quel ordre et qu'on ne pouvait pas, réellement, les séparer.
Alors j'ai démissioné.
Aussi : à la prochaine !
Mais n'oubliez pas de lire le reste. Notamment le
mini-conte de Borgès que nous a choisi Fawzi pour l'«extrait du mois».
C'est avec son punch line un chef-d'oeuvre.
Copernique

|
|
|
 Jeff Bollinger
Jeff Bollinger
Le paradoxe de Zénon
(Du livre dont je parlais le
mois dernier : Riddles in Mathematics d'Eugene P. Northrop
- Pelican, 1964)
Voici comment Wikipedia décrit
l'un des huit paradoxes de Zénon (± 490 à ± 430 avant J.-C.), celui qu'on nomme «Achille et la tortue» :
Dans ce paradoxe, il est dit qu'un jour, le héros grec Achille disputa une course à pied avec une tortue. Comme Achille était réputé être un coureur très rapide, il avait accordé gracieusement à la tortue une avance de cent mètres. Zénon affirma alors que le rapide Achille n'a jamais pu rattraper la
tortue parce qu'il ne pouvait pas.
En effet, supposons pour simplifier le raisonnement que chaque concurrent
allait courir à une vitesse constante, l'un très rapidement, et l'autre très lentement ; au bout d'un certain temps, Achille allait comblé ses cents mètres de retard et atteint le point de départ de la tortue ; mais pendant ce temps, la tortue
allait avoir parcouru une certaine distance, certes beaucoup plus courte, mais non nulle, disons un mètre. Cela
avait exigé alors à Achille un temps supplémentaire pour parcourir cette distance, pendant lequel la tortue aura avancé encore plus loin ; et puis une autre durée avant d'atteindre ce troisième point, alors que la tortue aurait encore progressé. Ainsi, toutes les fois où Achille
allait être à l'endroit où la tortue allait se retrouver, elle
allait se retrouver... encore plus loin. Par conséquent, le rapide Achille n'a jamais pu et ne pourra jamais rattraper la tortue.
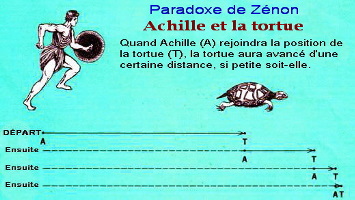
En voivi un autre (paradoxe), plus terre à terre :
Par testament, un homme laissa à ses trois fils 17 chevaux qu'il demanda à être répartis comme suit : la moitié à son fils aîné, le tiers à son fils puiné et un neuvième à son fils cadet.
Les chevaux étant de race, aucun des fils ne voulut appeler un boucher pour donner, par exemples, huit chevaux
et demi au premier des fils, cinq chevaux et deux tiers au deuxième et le reste au cadet.
Ils firent appel au sage de leur village qui, le lendemain arriva avec son cheval qu'il ajouta aux dix-sept à être
partagés et procéda à donner à l'aîné la moitié de dix-huit chevaux ou neuf. Au suivant, il en donna six chevaux (18 divisé par deux) et au troisième, deux, soit dix-huit divisé par neuf. Neuf + six + deux égalant dix-sept, il resta sur place un cheval, le sien, avec lequel il rentra chez lui.
C'est que 1/2 + 1/3 + 1/9 = 17/18 et non 17 sur 17. - Facile quand on y pense.
Dans le cas d'Achille et la tortue, la solution fut plus difficile à trouver :
Ce paradoxe du mouvement a stimulé les réflexions de grands mathématiciens tels que Galilée, Cauchy, Cantor, Carroll et Russell ; cela fit dire à Bergson que si les philosophes l'avaient réfuté de bien des façons et que ces façons étaient toutes différentes, chacune enlevait aux autres le droit de se croire définitive.
Ce n'est qu'au XXe siècle, presque deux mille ans et demi après Zénon
qu'une véritable résolution fut trouvée - mathématiquement - en utilisant le fait qu'une série infinie de nombres strictement positifs peut converger vers un résultat fini.
Pour de plus amples détails voir :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_d%27Achille_et_de_la_tortue
Reste maintenant à me pencher sur un Dieu en trois personnes.
Jeff

|
|
|
 Georges Gauvin
Georges Gauvin
Boss et boss
Il est onze heures. C'est vendredi. Le vendredi vingt-deux mars de l'an 2019. J'avais prévu aller en ville aujourd'hui. Mais on annonce de la pluie mêlée de neige et de
Dieu-sait-quoi. - Comme
dit Monsieur Popp : «Quand nous est tombé du ciel de la pluie, de la neige, de la grêle et du verglas, qu'est-ce qui peut encore nous
tomber dessus ?»
Sauf qu' il ajoute toujours : «Oui, mais avouez que c'est plutôt
rare.» Alors j'ai décidé de rester à la maison.
C'est malheureux car il est rare que j'ai une journée, comme ça, en plein
milieu de la semaine où je n'ai pas à me rendre au travail et pas le petit à m'occuper de.
J'ai congé aujourd'hui.
On est à repeindre la section où se trouve mon bureau. Aujourd'hui, demain et après-demain. Sauf que demain, c'est samedi et après-demain, dimanche et que je n'y serais pas allé de toutes façons.
C'est qu'on est à redécorer mon bureau, celui de mon adjointe et celui de mon boss qui, lui, est à Toronto, voir son boss dont le boss est le boss des boss et qui dit tout le temps qu'il a plusieurs boss : les propriétaires de la shop.
- Some boss : un bonhomme
en fauteuil roulant et qu'on voit jamais et les deux veuves de ses ex-associés, les fondateurs ou premiers boss. Ce qui fait qu'on a ben des boss : des boss, des sous-boss, des mini-boss et même des boss
d'employés qu'on ne voit jamais : ceux qui s'occupent
de vider les corbeilles la nuit et qui se rapportent aux propriétaires de
l'immeuble, leur boss qui a délégué sa bosserie à un sous
mais également un sur-boss.
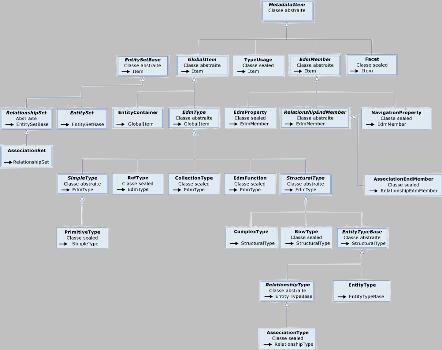
Mais il ne faut pas que je m'oublie pas parce que je suis une boss, moi aussi : la boss de mon adjointe, la boss de notre secrétaire qui, elle, a une autre boss : celle qui s'occupe des
employés subalternes et qui se rapporte au boss du bureau qui est également le boss des employés en charge du classement, des archives et des photocopieurs.
Ben des boss.
Il est onze heures. C'est vendredi. Le vendredi vingt-deux mars de l'an
2019.
Tiens, je vais appeler ma mère.
George

|
|
|
 Fawzi Malhasti
Fawzi Malhasti
Poésie choisie
Les yeux bleus
(Poème de Gaston Couté : 1880-1911)
Vous m'avez dit dans un sourire,
Que les yeux bleus (souvent songeurs),
Semblaient refléter et décrire
Les intimes penchants des coeurs.
Vous m'avez dit - lèvres sincères -
Que vous aimiez ce bleu profond,
Où vos yeux trouvaient plus sévères
Ces regards où tout se confond.
Où vos yeux trouvaient plus sévères
Ces regards où tout se confond.
Ces regards fixes qui résument
La haine ou la joie ou l'amour,
Ces regards bleus qui vous consument
Et font tout un siècle d'un jour.
Vous les adorez, chère Dame,
Aussi je les chante pour vous,
Mystique, divine est leur flamme ;
Vous les trouvez si doux.., si doux!
Mystique, divine est leur flamme ;
Vous les trouvez si doux.., si doux!
Vous m'avez dit dans un sourire,
Que les yeux bleus (souvent songeurs),
Semblaient refléter et décrire
Les intimes penchants des coeurs.
Vous m'avez dit dans un sourire
Que ces yeux dictaient les espoirs.
Pourtant... (laissez-moi vous le dire)
Pourquoi vos beaux yeux sont-ils noirs ?
Pourtant... (laissez-moi vous le dire)
Pourquoi vos beaux yeux sont-ils noirs ?
*
Notes :
Ce poème a été mis en musique par Michel
Desproges qui l'a endisqué en 2005 sur un CD dcomprenant 17 autres poèmes
de Gaston Couté. Son titre : Gaston Couté, Montmartre 1900 - Distribution Fortin
Productions - Mélodie DK 047.
Michel Desproches, chant et guitare avec : au
violoncelle, Philippe Bary et deuxième voix, Marion Maraux.
Paul qui m'a indiqué ces renseignements dit avoir
trouvé sa copie à la Libraire L'insoumise (Libraire anarchiste),
2033 boul. Saint-Laurent, Montréal.
Pour en écouter un extrait, cliquez sur la note :


Pour de plus amples rnseignements sur
Gaston Couté, consultez les sites suivants :
Dutempsdescerisesauxfeuillesmortes
gastoncoute.free.fr
Fawzi

|
|
|
 De notre disc jockey - Paul Dubé
De notre disc jockey - Paul Dubé
Beau printemps...
L'hiver étant
chose du passé (quoiqu'il a neigé là où je demeure au cours de la nuit
du 21 au
22 dernier), j'ai pensé passer tout de suite au printemps qui, comme on
le sait, ne dure que dix jours au Québec, parfois sept. - Il
fait tout à coup beau le lundi et le dimanche suivant tous les arbres
sont redevenus verts.
Pour ce légendaire
lundi - qui sera là d'ici peu - s'il n'est pas déjà apparu au moment où vous
lirez ces lignes, j'ai pensé vous faire entendre de la musique appropriée.
Je ne vous
dirai pas de qui c'est car j'en connais parmi vous qui, à la seule
mention du nom de son compositeur, pourraient passer à la chronique qui suit.
C'est au piano
et joué par une pianiste assez non-conventionelle, née à Singapore,
mais vous verrez : c'est comme une bouffée
de printemps.
Pour
écouter, cliquez sur la note : 
paul
P.-S. : Pour
les ultra-curieux, c'est l'oeuvre d'un compositeur américain décédé en
1992 et ça dure moins de huit minutes.
***
Note : pour nos suggestions et enregistrements précédents, cliquez ICI.

|
|
|
Lectures
Note :
Les textes qui suivent - et les précédents - ne doivent pas être considérés comme de véritables critiques au sens de «jugements basés sur les mérites, défauts, qualités et imperfections» des livres, revues ou adaptations cinématographiques qui y sont mentionnés. Ils se veulent surtout être de commentaires, souvent sans rapport direct avec les oeuvres au sujet desquelles les chroniqueurs qui les signent désirent donner leurs opinions, opinions que n'endosse pas nécessairement la direction du Castor™ ni celle de l'Université de Napierville.
|
William S. Burroughs - The Cat Inside - Penguin, 1992
Bon prince, j'ai consenti, contre mes habitudes, à lire cet opuscule de moins de cent pages parce que on me dit souvent
a) que je suis un écrivain (!) et b) que j'ai un chat. - Pour le point «b», je ne dis pas non.
- Pour le point «a», il est vrai que j'écris beaucoup, mais strictement
parce que - combien de fois je l'ai dit ! - c'est la seule façon que j'ai
pu trouver pour mettre de l'ordre dans mes idées.
Ce qu'on oublie de me souligner quand on avance ce qui précède, particulièrement en rapport avec le point «a», c'est que parmi mes écrivailleries,
j'émets souvent des opinions sur les écrivailleries des autres et ce, généralement, de façon péremptoire
(*), d'une chaire presque papale,
et des opinions qui exluent de facto toutes opinions qui pourraient être différentes.
(*) C'est-à-dire de façon qui est démodée, dépassé par le temps et même périmée.
Non, non et non, et... vrai en même temps : je suis
confiné dans un monde relativement limité comme ceux de tous ceux qui me donnent
leurs opinions sauf que les leurs sont le fruit de longues réflexions alors
que les miennes... Enfin, c'est ce qu'ils me laissent sous-entendre.
Cela étant dit, mis à part ma connaissance - même adjectif ou
qualificatif : limitée de certaines littérature - je suis zéro en ce qui a trait à la littérature post 1950 pour des raisons que j'ai déjà expliquées
- et le fait que j'attache la plupart du temps beaucoup plus d'importance au style qu'au contenu de ce que je lis (voyez ce que je dis de Gide ci-dessous),
j'ai quand même trois principes qui sont la plupart du temps à l'origine de, souvent, mes anathèmes concernant les écrits d'autrui :
1 - Il m'apparaît primordial d'essayer de comprendre ce qu'un auteur a voulu écrire.
(Et comment il s'est pris pour ce faire.) - Sauf que :
2 - Je constate irrémédiablement que contraitrement au principe précédent, il m'arrive plus souvent qu'autrement de penser à ce que je crois que l'auteur a voulu écrire.
Et que :
3 - J'attache énormément d'importance à ce qu'un auteur a peut-être écrit sans le savoir.
Passons maintenant à William S.
Burroughs, son
chat ou plutôt ses chats. - Carrément ? Pourquoi pas :
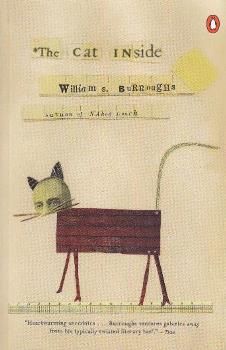
Dans son opuscule, je m'attendais à trouver des réflexions sur le rapport entre les chats et ceux - j'allais écrire : qui en possèdent, mais autant corriger tout de suite : -
ceux qui... vivent en osmose avec eux. Patiemment, j'ai lu, pages après pages, pour ne trouver qu'une série de phrases discontinues qui m'ont paru
n'être que des descriptions de faits divers tels que l'arrivée
saugrenue d'un chat sur sa table de travail ou le saut instinctif d'un félin
ou tout autre animal lorsqu'on lui apporte à
manger ; des faits divers qui auraient pu tout aussi bien être filmés comme ces bouts de
regardez-comme-il-est-mignon mini-vidéos
dont on peut en retrouver des milliers sur YouTube.
- Et pour être sûr de ne pas en avoir manqué une, j'ai les ai relues, une deuxième
fois et même en partie une troisième si je considère celles que j'ai
re-relues
au hasard.
La question qui m'est restée à l'esprit est demeurée la même :
pourquoi ce livre ?
Pas une seule phrase m'a semblé assez importante pour que je songe à la citer en exergue ou en en-tête d'un de mes toujours remarquables essais.
- Faut dire que si j'aime bien mon chat, je ne l'adore pas. - C'est après
tout, ce que je me suis dit, un animal qui demande beaucoup d'attention pour ce qu'il
m'en
donne en retour.
Mais revenons à The Cat Inside :
Son problème est que ce n'est pas le premier de ce genre de livres qu'il m'a été donné de lire au fil des ans. Je me souviens, entre autres, de
Je ne suis pas plus con qu'un autre d'Herry Miller (le seul livre qu'il ait écrit en français - mauvais d'ailleurs), d'une lettre sans intérêt de Joyce qu'un éditeur a jugé bon de faire paraître dans une édition numéroté (mille exemplaires ?) avec des dessins de
dieu-sait-qui et de nombreux passages inédits de Proust ne dépassant pas vingt pages y compris une presque thèse autour du fait que, dans
À la
recherche, il n'y avait aucun animal sauf le chien de Madame Sazerat,
au tout début...
Il y a là, à mon avis, une sur-exploitation de la notoriété d'un écrivain, conséquence de l'adoration sans borne de certains de ses lecteurs ou peut-être même - c'est fort possible - d'écrits alimentaires de la part d'auteurs en panne, mais qui doivent quand même continuer à payer leur tailleur.
Les lecteurs de D'Ormesson en ont été victimes lors de la publication de ses deniers livres ; nous en avons parlé ici-même.
Bah, les bouts de papier qui tombent dans la corbeille d'un génie pourraient - sait-on jamais - être importants...
Et puis dans le fond, qu'est-ce qu'on le lit pas de nos jours ? - La preuve est que vous venez de lire ceci.
Ce qui me ramène à mes trois principes :
1 - Est-ce que j'ai compris ce que Burroughs a voulu dire avec ce livre ? - Non.
2 - Est-ce que j'ai compris son intention en le faisant publier ? - Peut-être.
3 - Est-ce que j'ai été assez perspicace pour lire ce que Burroughs lui-même n'a pas tout à fait compris à savoir l'importance que ce livre pourrait avoir quant à une compréhension plus grande du personnage qu'il était. - Je ne sais pas :
Burroughs n'a jamais fait parti de mon monde littéraire, fort limité au
demeurant (comme je l'ai mentionné ci-dessus) surtout en ce qui concerne son époque.
Mon jugement ?
Je n'en ai aucun et la seule question que je me pose est : pourquoi a-t-on voulu que je lise
ce «The Cat Inside » de William S.
Burroughs, esq., mais j'ai bien peur qu'on ne me le dise jamais.
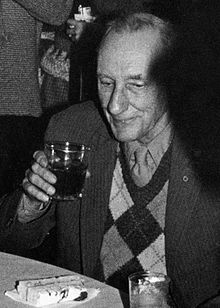
Mais tandis que je suis là, j'aimerais avant de vous quitter vous parler d'un film qui a eu un certain succès à
son époque, Candy de Chritian Marquand (1968), mais qui est aujourd'hui oublié
malgré la pléiade de comédiens qui en ont fait partie : Richard Burton, Charles Aznavour, Marlon Brando, John Huston, James Coburn et même Ringo Star, tous dans des rôles inhabituels
: Aznavour en acrobate bossu, Ringo en jardinier mexicain, Brando en gourou, etc., etc. - En vedette, une jeune fille naïve, jouée par Ewa Aulin qui sex-eploitée au cours d'une courte carrière a décidé que le cinéma n'était pas pour elle. - Mais le surprenant personnage interprété par Richard
Burton en vaut la peine : MacPhisto, un poète gallois, alcoolique, qui dit n'importe quoi (dont les livres ont été bannis dans 27 pays et 14 autres en phase émergeante) et qu'une foule d'admirateur ne cessent d'admirer béatement,
ce qui me ramène à William S.
Burroughs...
(Aux dernières nouvelles, ce film était disponible sur YouTube. Suffi de taper "candy 1968 ewa aulin" dans son moteur de recherche. - Burton y apparaît au tout début.)
Fin de cet aparté.
Il m'est tout de même resté quelque chose de
ce «The Cat Inside». Le souvenir que j'ai déjà eu en ce qui concerne
non pas Burroughs, mais un certain Gainsbourg qui m'ont tous les deux paru
faire partie du même monde. Je veux dire physiquement ou en apparence.
Vous saviez qu'il, Gainsbourg, a écrit, composé ou, à tout le moins, signé plus de 500
chansons ou mélodies ? - De ces 500, combien, vraiment, en a-t-on retenues ? - Est-il important de le savoir ? Ce qui est important
c'est se rappeler qu'il en a composées d'inoubliables.
Et j'enchaîne - je suis superexcité cette semaine - avec ce
que je pense de la correspondance des géants littéraires, à la suite
cependant de commentaires sur un autre livre..
Simon
***
Robert Mallet - Une mort ambiguë -
Gallimard, 1955
(Suivi de quelques remarques sur les livres de correspondance)
Pour me punir d'avoir récemment trop regardé d'insignifiantes nouvelles
sur Trump et son entourage, je me suis astreins à lire ce livre sur, tel qu'on le dit sur la dernière page de sa couverture
: la confrontation par personne interposée de deux hommes irrémédiablement brouillés (Gide et
Claudel), Mallet ayant été celui qui a servi d'intermédiaire entre les deux et qui, lors de la publication de leur correspondance en 1949-1950, y a joint une préface et des notes.
Je dis bien «pour me punir» car, à plusieurs moments, au cours de ma lecture, je me suis demandé pourquoi je persistais à lire un livre dont la correspondance
précitée n'a servi que de prétexte, pour l'admirable interviewer des
Entretiens avec Léautaud qui demeure un must à écouter,
pour écrire de longues disgressions sur ce qu'il pensait de la religion, la
foi, l'homosexualité et même ce qui doit arriver à la dépouille mortelle d'une
personnalité publique, disgressions toutes aussi captivantes les unes
que les autres, si vous vous intéressez à ce genre de choses.
(Ci-dessous je cite un passage de ces disgressions, une introduction
plus préciséement, qui vous donnera une idée du style qu'il a adopté lors de
sa rédaction.)

En bref, je n'ai rien appris de nouveau dans ce livre de 250+ pages sinon, peut-être,
ce qui s'est passé lors de la mort et les funérailles d'André Gide,
moment décrit tout aussi bien, sinon plus sobrement, dans
"Les cahiers de la petite dame" (Numéro 7 des Cahiers d'André
Gide - Gallimard - vols 4 à 7).
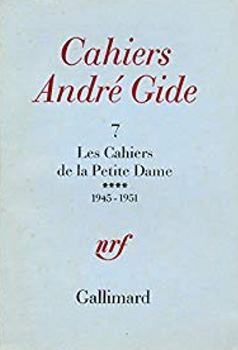
Je dois préciser qu'une bonne partie de son contenu rapporte verbatim diverses conversations entre l'auteur et Gide, l'auteur et Paul Claudel, les réflexions de Gide sur Claudel et
celles de Claudel sur Gide, mais aucune ne m'a paru importante au
point de les avoir notées.
À plusieurs endroits surgit Léautaud, avant et après la mort de Gide, mais rien de nouveau dans les entretiens qu'il
(Léautaud) a
eu par la suite avec l'auteur de cette Mort ambigüe et qu' on peut lire ou écouter ailleurs.
En d'autres mots, «Une mort ambiguë» n'est
qu'une suite de - on l'apprend en cours de route - pages d'un journal dont on pourrait
facilement se dispenser et desquelles on a oublié de supprimer les
descriptions inutiles. Par exemple, l'extrait qui suit qui sert de préambule à la visite de l'auteur et de Léautaud
à l'endroit où est enterré Gide :
«En ce jour où le printemps et l'été se confondaient, le soleil ruisselait sur toute la campagne. Les feuilles des hêtres avaient cette couleur claire et vernissée qu'elles perdent en vieillissant. Les alignements de troncs lisses autour des fermes et des pâtures s'enfouissaient dans leurs propres exubérances. Le bandeau mouvant des frondaisons supportait un ciel aussi lisse qu'une opaline. Le gris, le vert jaune et le bleu se moiraient de lumières diffuses qui dévalaient sur eux pour irriguer les champs verts-noirs où pointaient les épis de blé. Le toit d'ardoise de la petite église luisait de toutes ses écailles sous des averses de rayons qui rebondissaient à travers le cimetière dont les allées avaient la même teinte d'argile fauve que le chemin rural...» (Page 157)
Ce qui n'explique pas pourquoi j'ai persisté dans ma lecture.
Ah Oui, je m'en souviens : pour me punir d'avoir récemment trop regardé d'insignifiantes nouvelles
sur Trump et son entourage,
De la correspondance d'auteurs célèbres
Les rares ceusses qui ont eu la patience, un jour ou l'autre, de jeter un coup d'oeil sur ma bibliothèque dont les livres ont toujours été plus ou moins classés par éditeurs (et parfois par la couleur de leur
reliure - je l'ai déjà mentionné ici) ont dû, sans me le dire, se questionner sur la quantité des correspondances qui s'y trouvent ou s'y trouvaient avant les nombreux élagages que j'ai été obligé d'y faire faute d'espace, de moyen et lors de quelques déménagements. -
Y sont et s'y trouvent encore, pour la plupart, la correspondance de : Proust (21 volumes), les trois-quart de celle de Gide (avec Copeau, Ghéon,
Martin du Gard, sa mère, François Mauriac, Jacques-Émile Blanche, Dorothy Bucy, Valéry Larbaud, Francis Jammes, etc.), les quatre volumes de la correspondance de Pline le
Jeune, de nombreuses lettres de Joyce, d'Oscar Wilde et d'autres auteurs trop nombreux pour être nommés.

Ce qui aurait encore plus surpris ces rares ceusses qui se sont prêtés à cet examen auraient été encore plus étonnés d'apprendre que, sauf de rares exceptions (dont la correspondance de Pline le Jeune), je n'en ai, à toutes fins utiles, lues à peu près aucune. Mais alors à quoi sert-il d'avoir tout ça dans sa bibliothèque
auraient-ils pu me demander et je leur aurait répondu : on ne sait
jamais... et ça aurait été mentir un peu. Beaucoup même car je ne crois pas qu'il se soit passé une semaine et qu'il ne se passe pas encore une semaine sans que je n'ouvre un de volumes dans lesquelles ces correspondances sont imprimées pour y trouver une référence quelconque, pour retrouver, par exemple, le contexte dans laquelle une lettre est citée par un auteur d'un essai que je suis en train de lire ou tout simplement pour me renseigner sur un fait, un objet, une circonstance ou une
opinion quelconque. Tenez : récemment, je me suis plu à lire la correspondance de Proust avec son banquier. Ce fut un vrai délice que lire des phrases proustiennes utilisées dans un rapport que d'aucuns
pourraient dire aussi bassement matériel. Et puis, il faut lire une fois dans sa vie un auteur aussi brillant que Wilde écrivant à son cher Bosie ou encore le prodigue Joyce, toujours à court d'argent, écrivant à sa mécène ou son éditeur.
Car :
Autant je me plais à dire que le Journal de Goncourt est illisible, autant je serai d'accord pour dire que lire la correspondance intégrale d'un auteur (en particulier Proust dont on a conservé jusqu'à la moindre note) est une pure perte de temps. À moins qu'on soit en train d'écrire la thèse définitive (en son genre) sur le genre de cravate que portait Gide lors de ses sorties séductives...
Sauf que dans le cas de Pline le Jeune, ayez la patience de tout lire. -
Remarquez que, dans son cas, c'est lui qui a choisi quelles lettres étaient dignes d'être publiées.
Simon
***
Et puis finalement :
L'énigmatique André Gide
(Sur une [re]lecture de : L'école des femmes, Oedipe-Roi, Les faux-monnayeurs, Les caves du
Vatican, certaines pages de son Journal et divers Essais
ou Commentaires sur : Rodin, Balzac, Francis Jammes, Henri Ghéon, etc.)
Ayant, Copernique, Paul et - qu'est-ce qu'on dit ? - votre serviteur... passé plusieurs heures en compagnie de Gide au cours du mois dernier et de l'autre avant, il
nous est revenu à l'esprit une question que votre serviteur se posait déjà il y a plus de cinquante ans :
Est-ce qu'on lit encore André Gide aujourd'hui ?
En 1963, en effet, douze ans après la mort de celui qu'André Rouveyre avait surnommé «le contemporain capital»
(1)
Claude Martin (2)
se demandait s'il faisait encore partie de l'actualité littéraire :
Répondant à sa question («André Gide connaît le purgatoire qui n'épargne aucune gloire...»), il en souleva une autre : «Faut-il s'étonner que, de l'enquête menée en décembre 1960 par un hebdomadaire : "Dix ans après, que reste-il de Gide ?", il soit sorti de la bouche des jeunes écrivains interrogés, non pas même des sarcasmes, mais quelques phrases condescendantes et désabusées ?»
(3)
(1) Écrivain, journaliste, dessinateur de presse et caricaturiste, André
Rouveyre (1880-1962) fut, entre autres, ami de Gide, Apollinaire, Rémy
de Gourmont, Henri Matisse et Paul Léautaud.
(2) Professeur à l'Université de Lyon, Claude Martin, auteur et co-fondateur en 1968 de
l'Association des Amis d'André Gide, a édité des Correspondances majeures de l'écrivain, ainsi que les célèbres
Cahiers de La Petite Dame de même qu'établi l'inventaire de la correspondance générale d'André Gide
(environ 25 000 lettres). (Source : Babelio et autres)
(3) André Gide par lui-même - Édition du Seuil - Collections Écrivains de toujours, 1963.

À la lecture de ce qui précède, on peut, aujourd'hui, se poser une question beaucoup
plus significative : si, en fait, Gide est vraiment passé par un purgatoire
quelconque ou s'il n'a pas tout simplement cessé de faire partie de
l'actualité littéraire
dès sa disparition en rejoignant des écrivains qui furent ses contemporains et dont,
depuis des années, on ne peut lire les noms que dans des manuels scolaires sous la rubrique
«Écrivains du XXe siècle» (ou dans des éditions hors-prix).
Qui ? Paul Claudel, Jean Giono, André Malraux, François Mauriac, Henry de Montherlant, Jean Anouilh... auxquels on pourrait ajouter des écrivains très connus et même
fort louangés au cours de la première moitié du XXe siècle : Léon Bloy, Edmond Rostand, Alain-Fournier, Pierre Loti, Romain Rolland, Georges Bernanos, Albert Samain, Georges Bataille...
Je n'ai pas fait de longues recherches pour savoir si Gide était encore
disponible aussi facilement en 2019 qu'i l'était quand j'étais
jeune. - J'ai consulté quand même les catalogues de quelques bibliothèques puis examiné la liste des livres de Gide
toujours en vente à la FNAC, chez Amazon et Gallimard pour en conclure qu'à moins de se procurer les
six volumes de la collection La Pléiade (4)
et débourser plus ou moins 500 $ (323 Euros), l'oeuvre de Gide, à l'exception de certains livres aux titres suscitant une certaine curiosité
(L'immoraliste, les Faux monnayeurs ou encore Les caves du
Vatican), n'est accessible que sous la forme de livres plutôt
difficiles à trouver car ils n'ont jamais été republiées depuis des années.
(4) Journal, Tome I et II - Romans et récits (Oeuvres lyriques et dramatiques),
Tome I et II - Souvenirs et voyages et Essais critiques.
Il m'a fallu, par exemple, chercher assez longtemps pour trouver son Théatre - et encore : j'ai dû me contenter d'une édition de 1948 où, forcément, sa pièce tirée de ses
Caves du Vatican (1950) ne s'y trouvait pas, quoique encore en
vente,
séparément chez Gallimard, pour la modique somme de quelque 30$ et sur demande seulement dans une des quatre
des bibliothèques que j'ai consultées.
Ce que j'ai appris également, c'est qu'on publie encore et régulièrement, des études sur les divers aspects de Gide, sa vie et son oeuvre
dans quelques revues littéraires comparativement, par exemple, à l'inoubliable oublié Albert Samain, via, entre autres, l'«Association des amis d'André Gide»
citée ci-dessus et toujours en activité tandis
que, régulièrement, paraissent dans divers magazines spécialisées un article ou deux sur celui qui aurait été une
influence majeure (d'aucuns ont avancé une influence «dévastatrice») sur la jeunesse de 1900-1920.
S'il faut ajouter à l'oeuvre d'André Gide sa correspondance et les essentiels
Cahiers de la petite dame, alors là, autant, comme dit l'epression, «prendre son mal en patience». Les livres de Gide sont comme des perles : rares.
Et si coûteux qu'ils ne sont à portée de quelques uns.
Ce qui me fait dire, qu'à l'exception de quelques titres, Gide, ce «contemporain capital» n'est plus, aujourd'hui, lu,
sauf par quelques spécialistes et inconditionels comme ceux qui signent ces quelques
notes qui se sont procuré la majeure partie de son oeuvre au moment où
manger régulièrement n'était pas important.
- Il y a plusieurs raisons à cet état de choses. Pierre Lepape dans son livre
André Gide, le messager (1997, rééd. Points-Seuil, 2000) en donne une, et même deux :
« [Son oeuvre] réclame pour donner son sens et sa richesse d'être lue tout entière. Elle n'est pas faite en effet d'une suite de livres, comme autant de propositions séparées, mais des aventures, entre toutes émouvantes, d'une pensée en quête de liberté et de vérité. Chaque livre répond au précédent, qui répond à tous les autres, avec des avancées, des reprises, des contradictions violentes, des aveux et des rétractations, des audaces folles. Mais aussi des ruses et des prudences, des atermoiements et des tergiversations dont un autre livre balaiera les faiblesses. Chaque volume de l'oeuvre, roman, sotie, récit, essai critique, pièce de théâtre ou témoignage, se lit à la manière dont on lit une page de son journal, comme un morceau du paysage, une heure de la journée, une part de l'humanité, un moment de la dialectique. Ne pas lire tout Gide, c'est comme vouloir comprendre une pièce de théâtre dont on aurait effacé les dialogues.
[...]
«Diderot, qui était multiple comme Gide et qui, comme lui, cherchait sa vérité en l'incarnant dans des personnages contradictoires, avait choisi de secouer la langue elle-même pour lui donner l'allure du vivant. La dialectique faisait danser sa phrase. Gide, au contraire, a opté obstinément pour le classicisme. Né à l'écriture au moment où les langueurs éthérées du symbolisme se livraient à une guerre contre la
«vulgarité» naturaliste, il a choisi de renvoyer les deux adversaires dos à dos, en soumettant son art d'écrire à une tension permanente : enfermer sa liberté, sa spontanéité et son envie de tout dire dans les règles les plus strictes (voire les plus tatillonnes) du bien-dire classique.»
Lire toute son oeuvre ? Oui d'accord, mais qui, en 2019, aura la patience de ce faire ?
De consacrer plusieurs mois pour, d'une certaine manière, ne constater
qu'elle n'est qu'une suite de contradictions. - Quelques inconditionnels, dont
nous sommes, mais
l'idée ne nous en est jamais venue.
*
Je (simon) ne me souviens plus comment ni exactement pourquoi je me suis intéressé à Gide. Tout ce dont je me souviens c'est que c'est arrivé il y a plus de cinquante ans...
déjà !
C'était à l'époque où
paraissait le livre de Claude Simon que je ne lus que longtemps après.
- Je crois, mais je n'en suis pas certain, être venu à Gide (et non pas
vers lui) à cause de ses
Faux-Monnayeurs qu'on me disait à l'époque avoir été le premier vrai
Nouveau roman alors que j'en étais déjà à Joyce et au monumental
À la recherche du Temps perdu. - Je
me souviens
quand même de ne pas l'avoir lu en entier. Je me
souviens également, mais de cela précisément, avoir eu l'impression de lire un récit dont on pouvait deviner tous les fils ; l'équivalent de regarder un spectacle de marionettes dont les mouvements des personnages
auraient été trop saccadés pour paraître naturels, même en faisant
abstraction du fait qu'il étaient magistralement manipulés. Surtout que j'avais déjà vu à ce moment là, et en salle, L'année dernière à Marienbad d'Alain Robe-Grillet(1961) et en avoir être resté fasciné par ce qu'on appelait alors
l'avant-gardisme ou le Nouveau cinéma.
Les Caves du Vatican est venu après, mais exactement quand ?
Je ne sais pas. - Même réaction ou à peu près : pas l'oeuvre d'un
grand romancier.
Ma véritable rencontre avec Gide, si on peut appeler cela une rencontre, je l'ai eu via son
Journal deux ou trois ans plus tard quand je me suis mis à le
lire parallèlement à celui de Julien Green. Les deux furent et sont encore
mes deux grands livres de chevet. Mais pas pour les mêmes raisons :


Si je lis et relis Green pour ses idées, ses opinion, son fond, ce
n'est que pour le style et uniquement pour le style que je lis Gide ; pour ce qu'en
disait ci-dessus, Pierre Lepape : son «clacissisme», sa magnifique langue, ses plus-que-parfaits du subjonctif et ses tournures de phrases qu'il disait qu'il fallait prendre «par le bout qu'elles venaient».
Et Copernique et Paul d'ajouter : «Idem,
mais pas tout à fait».
*
Après les fleurs, le pot :
Notre opinion générale et directe ?
Gide est un grand auteur, mais également un grand emmerdeur.
Je (collectivement) le trouve tout simplement ennuyant et totalement dépassé. Il me
fait penser à ces auteurs qui, pour être à la page, se mêlent de
tous les débats au cours de leur existence et qui, quand
ces débats finissent par devenir viellots, surannés, caduques, disparaissent avec eux. - Pire encore : il m'apparaît au fur et à mesure que je continue à
lire Gide qu'il fut probablement, de son vivant, un grand flagorneur faisant semblant de tout détruire sur son chemin pour mieux
flatter l'intelligence de ses lecteurs et démontrer en même temps la
sienne. Un thuriféraire ?
(Comme aurait dit, ajoute Paul, une de mes tantes pour qui ce mot était le seul dont elle était sûr que personne d'autres dans son entourage pouvait comprendre). Peut-être.
Mais peut-être aussi un arriviste dans le monde littéraire. Enfin : un bonhomme qui, pour prouver sa légendaire «sincérité» changeait d'avis d'un journée à l'autre et qui - alors là je sens que les gidistes qui liront
ce qui suit vont crier au sacrilège - s'est flagellé publiquement pour avoir
loupé Proust qui avait soumis son premier roman à Gallimard. - (Faut lire les lettres qu'il lui écrivit par la suite pour l'intégrer dans la NRF.)
NOUS ne voulons certes pas dire qu'il n'y a rien de bon dans son oeuvre, mais
nous pensons ce qu'on disait à propos d'Anatole France :
Qu'il avait du génie, mais que ce génie a été mis aux
services de platitudes ; ou encore, comme Roger du Gard, son grand ami
- et surtout sinon plus grand défenseur - osa écrire : qu'il n'a jamais écrit ce chef-d'oeuvre que
son génie promettait...
Hélas ! Comme il disait lui-même de Victor Hugo.
*
À lire de lui - un must quand même, nous insistons - n'importe quoi si l'on ne s'attache pas trop à ce qu'il dit
sauf que son
Corydon tout comme sa «plaisanterie» en un acte, Le troisième arbre
(tout son théâtre en fait) et toutes les opinions qu'il a émises sur des livres que vous ne lirez jamais peuvent être exclus de votre
programme sans problème.
Quant à sa vie ou sa personnalité, vous serez en meilleure compagnie avec Green et même Oscar Wilde car je
(Paul) ne me souviens pas
avoir lu dans une des nombreuses biographies de Wilde (et Dieu sait ce
qu'on a écrites des pas piquées des vers) une description aussi terrifiante que celle de Robert Mallet (voir ailleurs dans ce
Castor™) d'un Gide âgé se pomponnant avant de rendre à une possible aventure galante.
Simon, Paul et Copernique

|
|
|
L'extrait du mois
Jorge Luis Borges - Everything
and Nothing (*)
(Anthologie personnelle - L'Imaginaire - Gallimard, p. 148, 2016
Oeuvres complètes - La Pléiade, vol. II, p. 24, 2010)
(*) Le titre de ce conte écrit en
espagnol était à l'origine anglais. - Il a été publié dans une suite
faisaint partie de El hacedor `(L'auteur et autres textes)
publiée à l'origine en 1960 et traduite en français en 1965 par Robert Caillois)
Note (Madame Fawzi Malhasti) :
Le parcours de cet écrivain né Jorge
Francisco Isodoro Luis Borges Acevedo en 1899, à Buenos Aires et décédé
à Genève en 1986 est assez particulier. Durant la Première Guerre
mondiale, il est en Suisse avec ses parents (où il fait ses études) pour
se retrouver à nouveau à Buenos Ayres en 1921 où il s'engage dans de
multiples acrtivités culturelles, fondant des revues, traduisant des
auteurs comme Kafka et Faulkner, mais s'intéressant surtout à
l'avant-gardisme espagnol. En 1930, il commence à écrire des contes et
des nouvelles, des récits policiers parodiques, des chansons (mises en
musique par Astor Piazzola) et se tourne peu à peu vers le fantastique,
le réalisme dit magique où il décrit des situations étranges qui lui
permettent, également sous la forme d'essais, une vision tout à fait
nouvelle de la réalité, de l'espace, du temps, de l'infini entremêlant
des personnages historiques, des êtres sans âme, des artistes dérisoires
ou imposteurs dans un style unique, souvent très concis d'où émergent
des paradoxes et des figures poétiques étonnantes.
Ce n'est qu'à partir
des années soixante que ses écrits commencèrent à être traduits et
que sa réputation se répandit dans le monde notamment en France, grâce
à l'écrivain Robert Callois, puis en Angleterre et aux États-Unis.
Voici un court conte qui donnera une idée
de son génie :
*
Il n'y avait personne en lui ; derrière son visage (qui même d'après les mauvaises peintures de l'époque, ne ressemble à aucun autre) et derrière ses propos, qui furent abondants, fantastiques et agités, il n'y avait qu'un peu de froid, un rêve que personne ne rêvait. Au début, il crut que tout le monde était comme lui mais l'étonnement d'un ami avec qui il avait essayé de commenter cette vacuité l'avertit de son erreur et lui fit comprendre pour toujours qu'un individu ne doit pas s'écarter des normes de l'espèce.
Une fois, il pensa qu'il trouverait peut-être dans les livres un remède à son mal et il apprit de cette manière ce peu de latin et cet encore moins de grec que devait mentionner un de ses contemporains. Il considéra ensuite que la pratique d'un rite élémentaire de l'humanité pouvait bien être ce qu'il cherchait et il se laissa initier par A***, au cours d'une longue sieste de juin.
Passé vingt ans, il se rendit à Londres. Instinctivement, il s'était déjà entraîné à simuler qu'il était quelqu'un, afin qu'on ne découvrît pas le fait qu'il n'était personne ; à Londres, il trouva la profession, à laquelle il était prédestiné, celle d'acteur, lequel, sur une scène, joué à être un autre, devant une assemblée de personnes qui jouent à le prendre pour cet autre. Le métier d'histrion lui apprit un bonheur singulier, peut-être le premier qu'il connût ; mais, le dernier vers acclamé et le dernier mort retiré de la scène, la détestable saveur de l'irréalité l'envahissait de nouveau. Il cessait d'être Ferrex ou Tamerlan et redevenait personne.
Aux abois, il se prit à imaginer d'autres héros et d'autres fables tragiques. Ainsi, pendant que son corps a'acuittait de son destin de corps dans les lupanars et les tavernes de Londres, l'âme qui l'habitait était César, qui fait la sourde oreille aux avertissements de l'augure,
et Juliette, qui déteste l'alouette, et Macbeth, qui parle sur la lande avec les sorcières qui sont aussi les Parques. Personne ne fut autant d'hommes que cet homme qui, à la ressemblance de l'Égyptien Protée, put épuiser toutes les apparences de l'Etre. Parfois, il laissait dans le recoin d'une oeuvre quelque confession, avec l'assurance qu'on ne la déchiffrerait pas ; Richard affirme ainsi qu'en un seul personnage il joua le rôle
de beaucoup d'autres et Iago dit étrangement : « Je ne suis pas ce que je suis. » L'identité fondamentale d'exister, de rêver et de représenter lui inspira des passages fameux.
Durant vingt ans il persista dans cette hallucination dirigée, mais il fut saisi un matin par la nausée et l'horreur d'être tant de rois qui meurent par l'épée et tant de malheureux amants qui se réunissent, se séparent et agonisent mélodieusement. Ce même jour, il décida de vendre son théâtre. Il retourna dans la semaine à son village natal où il récupéra les arbres et la rivière de son enfance et il ne les rattacha pas à ces autres que sa muse avait célébrés et que rendaient illustres allusions mythologiques et des vocables latins. II fallait être quelqu'un ; il fut un imprésario en retraite qui avait fait fortune et qui était passionné par les prêts, les litiges et la petite usure. En ces dispositions, il dicta le testament aride que nous connaissons et qui écarte délibérément tout trait pathétique ou littéraire. Des amis de Londres avaient coutume de visiter sa
retraite et il reprenait pour eux son rôle de poète.
L'histoire ajoute qu'avant ou après sa mort, il sut qu'il était en face de Dieu et il lui dit : «
Moi qui ai été tellement d'hommes en vain, je désire en être un qui soit moi.
» Au milieu d'un tourbillon, la voix de Dieu lui répondit :
« Moi non plus, je ne suis pas : j'ai rêvé le monde comme tu as rêvé ton oeuvre, Shakespeare, et tu fais partie de mon rêve, toi qui es multiple comme moi et, comme moi, personne.»

|
|
|
Il y a dix ans dans
le Castor™
Note :
Les textes qui suivent - et les précédents - ne doivent pas être considérés comme de véritables critiques au sens de «jugements basés sur les mérites, défauts, qualités et imperfections» des livres, revues ou adaptations cinématographiques qui y sont mentionnés. Ils se veulent surtout être de commentaires, souvent sans rapport direct avec les oeuvres au sujet desquelles les chroniqueurs qui les signent désirent donner leurs opinions, opinions que n'endosse pas nécessairement la direction du Castor™ ni celle de l'Université de Napierville.
|
S
Jeff

|
|
|
Le courrier
Mme Porsépine Ouellette - Ville Émard,
Québec
Statistiquement ? L'Oxford University
Press mentionne dans son Christian Encylopedia que 84% de la
population mondiale se dit membre d'une religion quelconque ou croit en un
être suprême. - De ces 5,9 milliards d'individus, 2 milliards seraient chrétiens
dont la moitié se disent catholiques, 1 milliard musulmans, 500 millions
hindous , 400 millions boudhistes et 700,000 déistes, anémistes au
autres. Existerait environ 10 mille religions qui se subdiviseraient en
diverses branches. les chrétiens, par exemple, compteraient environ
34,000 sous-divisions. - La question que se posent les sceptiques face à
ces statistiques est toujours la même : quelle est la possibilité qu'une
de ces religions ou subdivisions soit la vraie compte tenu que les
milliards d'individus qui se disents membres des autres soient, de ce
fait, dans l'erreur ?
M. Johnny Ricardou - Drake,
Saskatchewan
Probablement oui. Dans un monde parallèle
comme celui conçu par Max de Broglie, Louis Bohr, Albert Planck et Neils Einstein.
M. Josaphat
Lavallée - St-Léonard-de-Port-Maurice, Québec
Vous dites que vous faites partie de
ceux qui vivent, selon la formule consacrée, «de payes en payes»
? - Nous vous en faites pas : vous faites partie de 78% de la population
des travailleurs salariés. - Faites attention quand même car, si vous ne
changez rien à vitre style de vie, vous allez éventuellement faire
partie des 32% des Canadiens âgés entre 45 et 64 ans qui n'ont rien,
mais absolument rien de prévu pour leur retraite.
Madame Sophie
Lemarchand - 87030, Gesuiti, Italie
Vous avez raison, mais les mathématiques usuelles peuvent également être théoriquement développées entièrement dans le cadre de la théorie de Zermelo et Frankael en
leur ajoutant des axiomes comme ceux des grands cardinaux, pour certains développements
et ceux faisant partie de la théorie des catégories par exemple, quoique il n'est pas certain que Thoralf Skolem eut été d'accord sur ce point.
M. Télesphore
Gravel - Pompano Beach, Florida
The John and Mable Ringgling Museum of Art,
à quelque 200-225 kilomètres de votre résidence (que nous supposons être
votre résidence secondaire) dans la municipalité de Sarasota, sur le
Golfe du Mexique. - Empruntez l'autoroute I-75, en passant par Naples.
C'est la route la plus rapide. - Vous y trouverez, entre
autres, une grande toile dont nous ne souvenons plus du nom du peintre et qui
s'intitule French Notables. Il date de 1898 et vous remarquerz que
la femme, à droite, est Sarah Bernhardt (1844-1923) :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:French_Notables_(1889),_Ringling_Museum.jpg?uselang=fr
M. Harbin Galarneau - Nelson 7010,
Nouvelle-Zélande
Le Syndicat des Pêcheurs en Hautes
Montagnes de Tracy, à l'adressse qui suit :
Syndicat,
etc.
Ms Pascaline Jobin - Kelly, PL16 5FR, UK
The Art School of Toronto ou Le
Toronto School of Art :

24 Ryerson Avenue
Toronto, Ontario
M5T 2P3

|
|
|
Dédicace
Cette
édition du Castor est dédiée à :
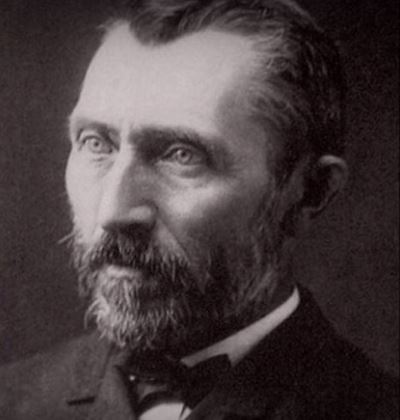
Vincent van Gogh
(1853-1890)(Et dont la photo ci-dessus est la seule connue)

|
|
|
Le mot de la
fin
«On croit mourir pour la patrie ; on meurt pour des industriels.»
- Anatole France - L'humanité
- 18 juillet 1922

|
|
|
Autres sites à
consulter

Webmestre : France L'Heureux

Webmestre : Éric Lortie

Webmestres : Paul Dubé et Jacques Marchioro
|
|
|
Notes et autres avis
Clauses et conventions :
Le Castor™ de
Napierville est le fruit de plusieurs interventions de la part d'une
multitude d'intervenants :
-
En tête, son
programmeur qui a pour tâche de transformer son contenu en
fichiers HTML de telle sorte à ce qu'il puisse être diffusé en
textes lisibles sur Internet
-
En arrière-plan,
son éditeur qui réunit dans un ordre pré-établi les textes et
images qui en font parti
-
Les chroniqueurs,
chercheurs, concepteurs qui en rédigent chaque numéro.
-
Viennent ensuite
les correcteurs, vérificateurs, inspecteurs et surveillants qui
en assurent la qualité.
mais d'abord et avant
tout :
Autres informations,
conditions et utilisation
Le Castor™ de
Napierville est publié une fois par mois, le premier lundi de chaque
mois.
En haut, à gauche, à côté
de la date, est indiqué le numéro de sa version ou de son édition. Le
numéro1.0 indique sa première et suivent, selon les correctifs, ajouts
ou autres modifications, les numéros 1.2, 1.3, 1.4.... 2.0, 2.1, 2.2
etc. - La version 3.0 indique qu'il s'agit de son édition finale qui, généralement,
coïncide avec sa version destinée au marché américain, celle qui
paraît en principe avant ou le jeudi suivant sa première édtion.
Si le Castor™ de
Napierville a un siège social, il n'a pas de salle de rédaction et
compte tenu de la situation géographique de chacun de ses
collaborateurs, tout le ci-dessus processus se déroule in auditorium
c'est-à-dire en présence du public via l'Internet.
Nous prions nos lecteurs,
etc.
Historique :
Fondé en 1900 par le Grand Marshall, le CASTOR DE NAPIERVILLE fut, à l'origine, un hebdomadaire et vespéral organe créé pour la défense des intérêts de l'Université de Napierville et de son quartier. - Il est, depuis le 30 septembre 2002, publié sous le présent électronique format afin de tenir la fine et intelligente masse de ses internautes lecteurs au courant des dernières nouvelles concernant cette communauté d'esprit et de fait qu'est devenu au fil des années le site de l'UdeNap, le seul, unique et officiel site de l'Université de Napierville.
De cet hebdomadaire publié sur les électroniques presses de la Vatfair-Fair Broadcasting Corporation grâce à une subvention du Ministère des Arts et de la Culture du Caraguay, il est tiré, le premier lundi de chaque mois, sept exemplaires numérotés de I à VII, sur papier alfa cellunaf et sur offset ivoire des papeteries de la Gazette de Saint-Romuald-d'Etchemin et trois exemplaires, numéroté de 1 à 3, sur offset de luxe des papeteries Bontemps constituant l'édition originale, plus trois exemplaires de luxe (quadrichromes) réservés au Professeur Marshall, à Madame France DesRoches et à Madame Jean-Claude Briallis, les deux du Mensuel Varois Illustré.
Autres informations :
1 - Sauf indications contraires : Tous droits réservés. - Copyright © UdeNap.org. - La reproduction de tout ou partie du matériel contenu dans cette édition du Castor™ est interdite sans l'autorisation écrite des auteurs.
2 - Malgré l'attention portée à la rédaction de ce journal, ses auteurs ou son éditeur ne peuvent assumer une quelconque responsabilité du fait des informations qui y sont proposées.
3 - Tel que mentionné ci-dessus : les erreurs de frappe, de date et autres incongruités contenues dans ce Castor™ seront ou ont déjà été corrigées dans sa version destinée au marché américain.
4 - La direction du Castor™ tient à préciser qu'aucun enfant n'est victime d'agressions sexuelles au cours de la préparation, pendant la rédaction et lors de la publication de son hebdomadaire.
 . .
|
| |
Liens :
Le Castor™ - Index (2018, 2019, 2020)
Le Castor™ - Fondation et équipe originelle
Le Castor™ - Organes affiliés
*
Le Castor™ - Édition précédente
Le Castor™ - Édition suivante
Le Castor™ - Édition courante

|
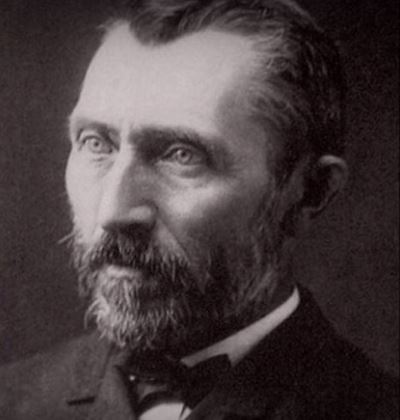


 Simon Popp
Simon Popp
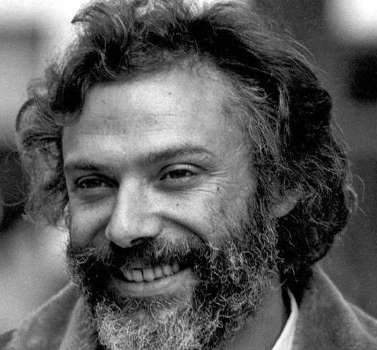



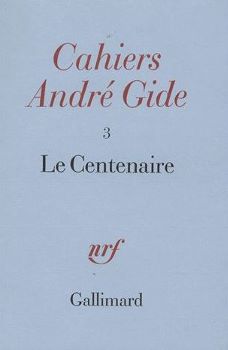



 Herméningilde Pérec
Herméningilde Pérec

 Copernique Marshall
Copernique Marshall
 Jeff Bollinger
Jeff Bollinger
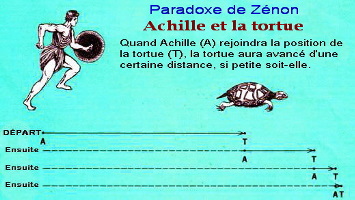
 Georges Gauvin
Georges Gauvin
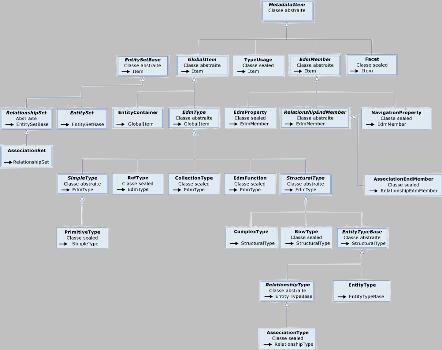
 Fawzi Malhasti
Fawzi Malhasti

 De notre disc jockey - Paul Dubé
De notre disc jockey - Paul Dubé